![]()
Photos : page de photos 13 - 8- 3
Une autre
voie romaine, celle qui traverse l'Aubrac :
étape
3 : de
la
route de Montorzier au
pont
de Marchastel
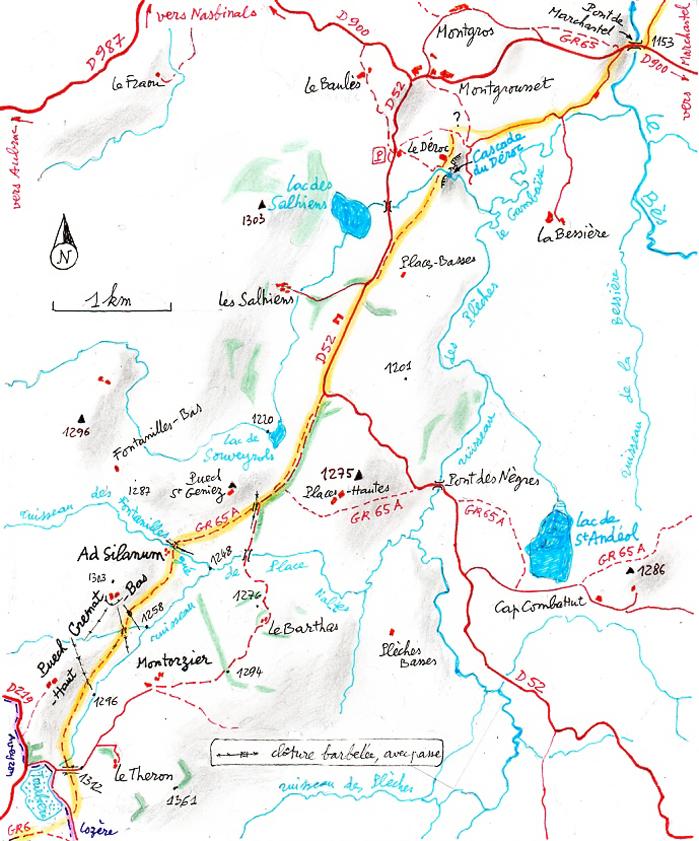
Carte n° 3 : carte
d'une partie (lozérienne) du haut-plateau de l'Aubrac, dont la voie
romaine traverse les vastes pâturages depuis la région
des Puech Crémat jusqu'à la cascade du Déroc et le
pont de Marchastel.
Un circuit pédestre est recomandé (il
peut à la rigueur être parcouru à VTT, mais à certains
endroits l'herbe est haute sur un sol irrégulier, et il y a les clôtures
barbelées à franchir) : départ près de la tourbière
; route de Montorzier ; Montorzier ; piste passant par un ancien buron, Le
Barthas ; pont sur le ruisseai de Place Naltes ; carrefour avec la voie romaine
(d'où on peut faire une incursion jusqu'à la route D 52) ; puis
la voie romaine dans les pâturages, par Ad Silanum, jusqu'à la
tourbière.


Les immenses pâturages du haut-plateau
de l'Aubrac, en particulier ceux du large vallon drainé par le
ruisseau de Place Naltes et son affluent, le ruisseau des Fontanilles. On
aperçoit : à droite, au pied d'un bouquet d'arbres, le
haut du toit de l'un des bâtiments du Puech-Crémat-Haut ; et
à gauche, plus loin, le Puech-Crémat-Bas qui se signale
aussi par un bouquet d'arbres.
Les moutonnements du relief sont liés à l'érosion
glaciaire de l'ère quaternaire, époque où, jusque vers
-12000 ans, l'Aubrac, partie de la chaîne de montagne hercynienne réduite
à l'état de pénéplaine, était recouvert
par une calotte de glace.
Récemment ont été plantés des rangées
de sapins permettant aux troupeaux de s'abriter par mauvais temps.
Cliquer sur la photo pour l'agrandir.
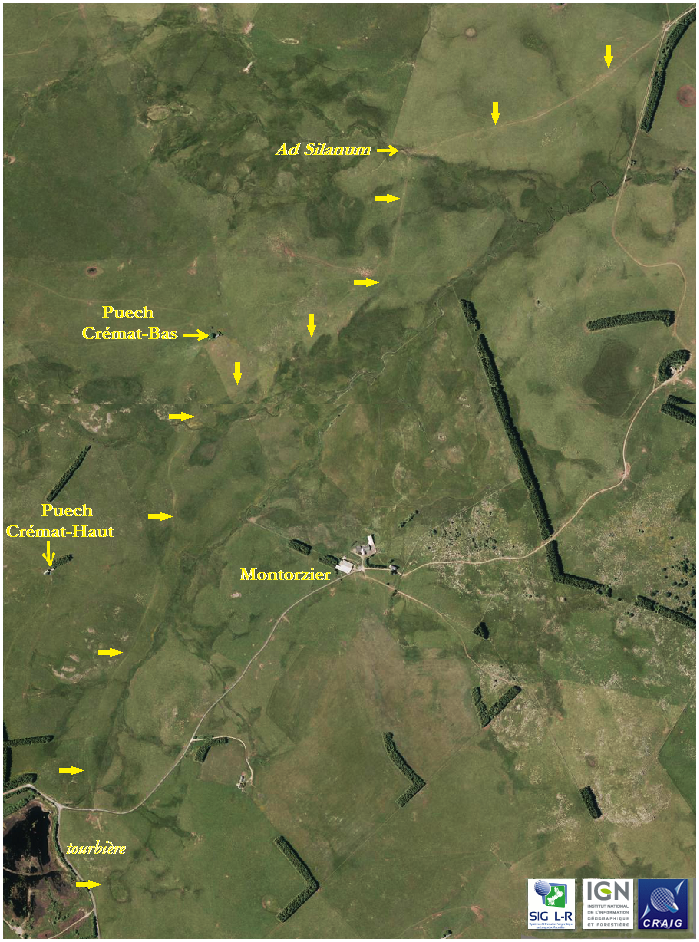
Vue aérienne
(IGN-Géoportail) de la région des Puech Crémat
Haut et Bas. Dans les hautes herbes de cette région, typique de
l'Aubrac, la trace de la voie romaine est à certains endroits difficile
à repérer sur le terrain. Elle est visible sur cette photo aérienne.

Photo prise de la route de Montorzier
à l'endroit où le tracé de la voie romaine la coupe
(et où on trouve encore l'ancien balisage du GR 5), à 100 mètres
de la tourbière. Le tracé, d'abord difficilement repérable,
longe la clôture, puis s'en écarte progressivement et devient
plus visible. Au loin on voit les deux bâtiments du Puech Crémat-haut,
au-dessous duquel passe la voie.

A mi-hauteur de l'image : le maigre ruisseau
de Place Naltes, peu après être issu de la tourbière (non
visible sur la photo, à droite). Au-dessus : les pâturages verts
de sa rive droite, avec la petite route de Montorzier, et le buron du Théron
(derrière un bouquet d'arbres). La voie romaine traverse les pâturages
jaunâtres de sa rive gauche, au-delà des vaches, au-dessous de
la zone rocheuse qu'on voit à gauche.
Haut
de page

Les deux bâtiments du Puech-Crémat-Haut.
Le nom "Crémat" viendrait
de ce que lors de la guerre des Gaules Vercingétorix a donné
l'ordre de pratiquer la politique de la terre brulée pour affamer les
armées de César, politique d'ailleurs réciproque.

Curieuses, ou croyant avoir affaire à
leur vacher, les vaches ont regardé l'auteur du site ramper sous les
barbelés, qui sont doublés par un fil de fer electrifié.
Il est difficile de savoir ce qu'elles en pensent
Une "passe" (petite échelle de deux ou trois
marches ; voir plus loin une photo), ou un passage en baïonnette,
permet de franchir la plupart de ces clôtures, mais pas toutes.

Le plus souvent les vestiges de la voie
romaine, au milieu de ces pâturages, dans les faibles pentes qui descendent
vers le petit ruisseau de Place Naltes, se présentent ainsi : une faible
rupture de pente, à flanc de coteau, ou un petit talus, le tout
à peine marqué,forme une vague trace dans les hautes herbes.
A l'arrière-plan cette trace se devine sur la photo, légérement
ascendante vers la gauche, dans la pente herbeuse. L'attention est requise
pour ne pas perdre ces faibles indice.s
Haut
de page

Au-delà des fleurs de Grande
gentiane, emblématiques de l'Aubrac, on aperçoit la voie romaine
décrivant une courbe en direction d'un troupeau de vaches et du Puech-Crémat-Bas,
qui se signale par un bouquet d'arbres.

Le Puech-Crémat-Bas, vu de
près, ancien (ou actuel ?) buron, qui domine la voie romaine et plus
loin le site d'Ad Silanum.
Au premier plan l'une des belles vaches de la robuste race
Aubrac (élevée principalement pour sa viande, un peu pour
son lait), et son veau.

A certains endroits émergent
des blocs de basalte du soubassement de la voie.

Vue générale du site, au nord-est
et au-dessous de Puech-Crémat-Bas, des maigres vestiges de la station-relais
de Ad Silanum. On voit, à gauche, le ruisseau des Fontanilles,
qui coule de la gauche vers la droite, et le long duquel on distingue la clôture
barbelée. Même lorsqu'on est sur le terrain la voie romaine ne
se détache pas bien, là aussi, sur l'herbe environnante : on
devine sa trace au premier plan et, au-delà de la clôture qui
longe le ruisseau, sous l'aspect d'un trait oblique qui monte sur la hauteur
de la rive gauche du ruisseau.

 |
La
table de Peutinger est la copie médiévale d'une ancienne
carte romaine (dressée au début du IIIe siècle et
à la fin du IVe), copie découverte en 1494 à Worms
en Allemagne occidentale, et ayant appartenu à un humaniste allemand,
Konrad Peutinger. C'est une carte routière très schématique de l'Empire romain, ainsi que du Proche-Orient et de l'Inde, se présentant sous la forme d'une bande de parchemin de 6,80 m sur 0,34 m. Y figurent les routes principales, sous forme de lignes droites ou brisées (avec mention des distances), les villes, les stations-relais, mais aussi les forêts, les montagnes, les fleuves, et les mers. Elle contient des erreurs de copie. |
Au milieu de cet extrait de
la table de Peutinger figure le nom "Ad silanum", en
tant que station-relais sur la voie qui va de "Segodum" (nom tronqué,
pour Segodunum, Rodez) à Anderitum (Javols), située à
XVIIII lieues gauloises (égales à 2222 m) de la première,
soit en gros 54 km, ce qui est proche de la réalité, et XVIII
de la seconde, soit 40 km, ce qui est supérieur à la réalité
(erreur de copie ?). A noter aussi la ville thermale Aquis Calidis (Vichy)
et la voie qui, passant par Condatomago (Millau) va de Segodunum à
Cesserone (St-Thibéry, près d'Agde, sur la via Domitia, qui
longe la Méditerranée).
Les archéologues ont longtemps débattu de la question
de savoir où se situait cette station assez importante pour être
mentionnée sur la table de Peutinger. Dès 1866 a été
émise l'hypothèse que les maigres vestiges gallo-romains qu'on
trouve en plein Aubrac, au pied du Puech de Crémat-Bas, sur la rive
droite du ruisseau des Fontanilles, étaient ceux de Ad Silanum (dont
une des étymologies proposées est celle-ci : les mots latins
ad : près de, et silanus : eaux vives, source). Etayée
plus tard par (entre autres) des notions de distance, cette hypothèse
est maintenant considérée comme étant très probablement
la bonne
 |
Sur cette carte des
provinces romaines établie au XVIIe ou XVIIIe siècle (peut-être
inspirée par la carte de Peutinger), Ad Silanum figure aussi
sur la voie romaine entre Segodunum (Rodez), capitale du pays des "Rutheni",
et Anderitum (Javols), capitale du pays des "Gabali". Mais entre ces deux villes c'est la seule localité signalée, ce qui plaide en faveur de son importance. |
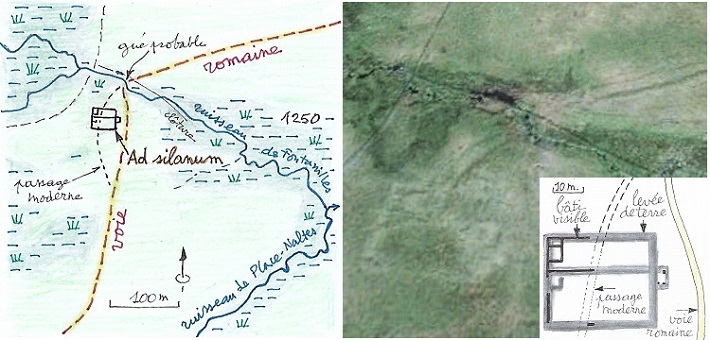
Carte localisant les vestiges du bâtiment
appelé Ad silanum ; une vue aérienne (Google earth)
de ces vestiges ; et un schéma figurant son plan, avec indication
du bâti encore visible (extrait du document Pdf consacré dans
son site à la voie romaine de l'Aubrac par le club "Archéologie
et Patrimoine de la Maison des Jeunes et de la Culture" de Rodez : cliquer
ici).
VOIR AUSSI dans la revue Patrimoni, n° 91; Mars-Avril 2021,
un article de Charlène Routaboul intitulé L'habitat rural
en Aveyron durnt l'antiquité : Ier siècle avant J-C au Ve suècle
après J-C, pages 10 et 11.

Vue vers le sud : le ruisseau de
Fontanilles, un peu en amont du gué (qui se résume aujourd'hui
à deux ou trois blocs rocheux) par lequel la voie romaine le franchissait.
A gauche la clôture de barbelés qu'une baïonette permet
de franchir facilement.

Les vestiges de Ad Silanum se résument
presque à ces tas de cailloux. Au loin : le hameau de Montorzier.

Les vestiges incluent cependant la base
d'un mur, bien visible sur deux ou trois mètres de long, construit
de deux à trois rangées de moellons de basalte et de granit.
Ces vestiges ont été fouillés. La station
comportait deux bâtiments : l'un sur la rive gauche du ruisseau, l'autre
sur la rive droite, plus grand (36 m sur 30) dont l'emplacement est actuellement
traversé par le chemin. Les fouilles ont révélé
la présence de monnaies, de fragments de poteries (en faveur d'une
date approximative : du Ier au IVe siècle), de tuiles (tegulae
en latin), ainsi que de cendres et de charbon (la station a peut-être
été incendiée lors des invasions barbares).
Elle était peut-être une "mansio"
(comme à Mancioux, village au sud de la Haute-Garonne), c'est-à-dire
une auberge où on pouvait manger, coucher, garer ou réparer
son attelage. Il y en avait tous les 30 à 50 km le long des voies romaines.
Il n'est pas exclu cependant qu'il se soit agi d'une simple "mutatio",
relais où on pouvait changer de monture et faire une pause, au milieu
d'une étape (il y en avait souvent trois entre deux mansiones ;
il y avait aussi des auberges : "tabernae", ou "cauponae"
de moindre standing ).
Pour en savoir plus
sur la station-relais Ad Silanum consulter sur le web :
- un
document pdf téléchargeable dans le site du Club Archéologie
et Patrimoine de la MJC de Rodez (cliquer
ici) ;
- la page du site Aurelle-Verlac consacrée à
Ad Silanum (cliquer
ici) ,
- dans Wikipedia l'article Ad Silanum (cliquer
ici).

A environ 3 km à l'est de Ad Silanum se situe le
lac de Saint-Andéol qui a constitué dans le passé,
avec le promontoire qui le domine à l'est (Mons Helarius), un lieu
de culte peut-être associé à la station-relais.
Sur cette photo du lac, prise vers l'est, on voit à l'arrière-plan
la zone du plateau où se situe Ad Silanum.
Le GR65A, variante
non balisée du GR65 (sentier vers St-Jacques-de-Compostelle), passe
par les deux sites et plus à l'ouest emprunte la voie romaine.

Sur le promontoire qui, à l'est, domine le lac (Mons
Helanus) avait été installé un temple (fanum)
gallo-romain dont les maigres vestiges ont été fouillés.
Des cérémonies religieuses (avec des rites païens,
en particulier des offrandes jetées dans le lac) s'y sont déroulées
jusqu'au XIXe siècle. Au Moyen-âge le lieu a été
christianisé par la construction d'une église, au nord-est du
lac, en l'honneur de Saint-Hilaire.
Ce promontoire est un entablement d'origine volcanique :
il y a 6 à 8 millions d'années (fin du Miocène) des coulées
de lave basaltique montées par des fissures ont partiellemenrt
recouvert (sur jusqu'à 300 m. d'épaisseur) les terrains granitiques
et métamorphiques (un peu exhaussés par le contre-coup de la
surrection des Alpes) de l'ancienne chaîne de montagne hercynienne réduite
par l'érosion à l'état de pénéplaine. L'ensemble
a subi à l'ère quaternaire, jusque vers -12000 ans, une érosion
par une calotte de glace de 200 m. d'épaisseur, et par les glaciers
auxquels elle donnait naissance, érosion dont témoignent des
blocs erratiques et des lacs de surcreusement, dont le plus important est
celui de St-Andéol.
Haut
de page


La voie romaine au nord-ouest du site
de Ad Silanum. C'était l'ancien tracé du GR 65 : il n'en 'est
plus que la variante 65 A, peu ou plus balisée, qui, venant
de Rieutort-d'Aubrac et du lac d'Andéol, suit vers le sud-ouest la
voie romaine jusqu'à la route de Montorzier.

Ici (au deuxième plan, en haut
à gauche de l'image, à l'aplomb du hameau de Montorzier qu'on
voit au loin) la voie a été aménagée sur une levée
de terre, 1 à 2 m. au-dessus des terrains environnants.

Une passe pour permettre aux randonneurs
de franchir la clôture, ici à l'endroit où la voie (sa
trace est visible au milieu de l'image) vient confondre son tracé avec
celui d'une piste qui depuis Montorzier mène, 1 km plus loin,
en longeant une étroite forêt, à la route D 52 de Saint-Germain-du-Teil
à Nasbinals (route qui plus à l'est passe à proximité
du lac de Saint-Andéol et par le col de Bonnecombe).
Haut
de page

Peu après le chemin se dédouble
: la voie romaine (à gauche) longe la piste (à
droite) jusqu'à la route D 52.

La voie passe là à proximité
du lac de Souveyrols.

Lorsque la piste s'embranche sur la route
D 52, dans un virage, le tracé de la voie romaine va se se confondre
avec cette route sur un peu plus de 1 km, à partir de la cote 1233
de la carte IGN jusqu'à la cote 1218 où elle s'en détache
vers la droite (à hauteur du bois qu'on
voit au fond) pour la cotoyer ensuite sur environ 300 m.
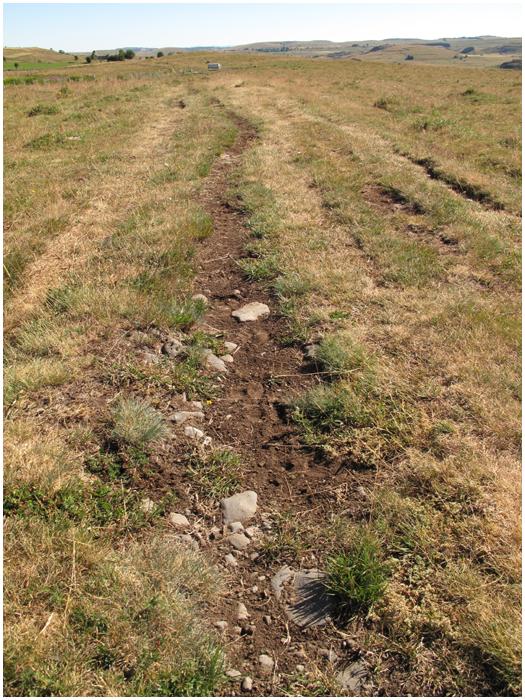
Elle s'en éloigne ensuite, sur un
petit plateau basaltique, en direction (nord-est) de la ferme Le Déroc
(qu'on voit au loin). Il est probable que ces traces de chemin sont bien celles
de la voie romaine.
Haut
de page

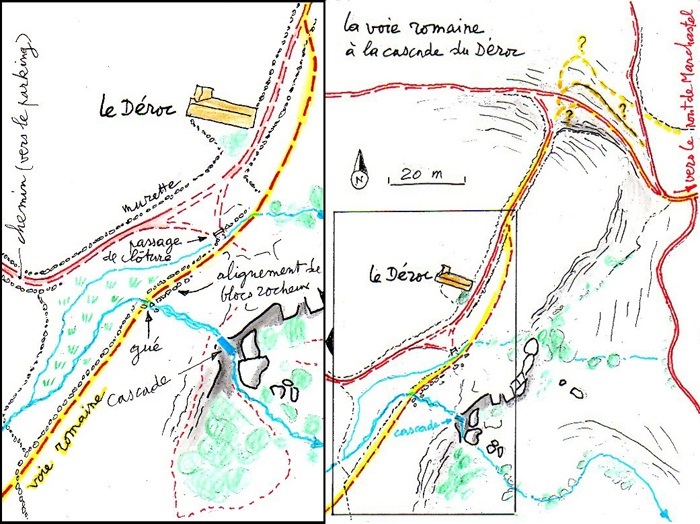
Carte du probable tracé de la voie romaine dans la
traversée du petit plateau basaltique qui domine la large vallée
de la rivière Le Bès et d'où s'élance la cascade
du Déroc. La voie romaine passait sur un gué, semble-t-il,
le ruisseau issu du lac des Salhiens (qui est 1km au sud-ouest), une
vingtaine de mètres en amont de la cascade. Plus loin son tracé
se confond avec le chemin de la ferme du Déroc, mais il est difficile
de localiser sa descente sur la plaine, où la route qui rejoint la
D900 au pont de Marchastel la recouvre..

Vue, vers le nord, sur la falaise
bordant le petit plateau basaltique d'où s'élance la cascade
du Déroc (dont on voit le point de départ à gauche),
et sur la plaine qu'elle domine, où se déploient, dans une zone
marécageuse, les multiples méandres de La Gambaïse, rivière
qui, plus au nord, se jette dans la rivière Le Bès.
La voie romaine passait, sauf erreur, à une vingtaine
de mètres à gauche de la cascade.
Dans cette zone existait un site gallo-romain.

La cascade du Déroc, à un
endroit où la falaise forme un surplomb, partiellement effondré.
Sa hauteur : 33 m..
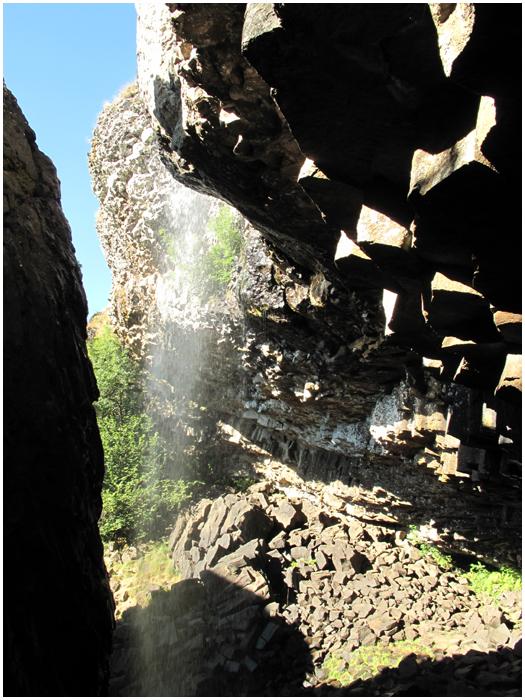
Sous le surplomb les orgues basaltiques
sont impressionnantes.

Ces blocs rocheux correspondent probablement
au gué sur lequel la voie romaine traversait, une vingtaine
de mètres en amont de la cascade, le ruisseau issu du lac des Salhiens.

Après le gué, alignement,
sur une vingtaine de mètres, de blocs de basalte dont on peut penser
qu'ils faisaient partie de l'armature de la chaussée de la voie romaine.

Ce chemin est sans doute la voie romaine, à l'endroit où
ayant traversé le petit plateau basaltique d'où se jette la
cascade, et après être passé près de la ferme
"le Déroc" (qu'on voit au loin), elle commence à
descendre dans la plaine où s'étalent les méandres des
rivières La Gambaïse et Le Bès.
Haut
de page

La
voie romaine franchissait sur ce pont, dit de Marchastel, la rivière
Le Bès qui serpente sur le haut plateau de l'Aubrac, dans un
large vallon, avant de descendre au nord dans des gorges vers la Truyère,
affluent du Lot. Ce pont est réputé
être un "pont romain" : en fait
la voie romaine franchissait peut-être la rivière par un gué
localisé quelques centaines de mètres au nord.
C'est actuellement la route D 900
qui la franchit ici sur ce pont, à 1,3 km à l'ouest de Marchastel.
La petite route qui recouvre la voie romaine après la cascade du Déroc
s'y branche, une centaine de mètres avant le pont, sur la rive gauche
(voir la photo suivante).

Le pont de Marchastel, sur
le Bès, vu du sommet du Puech del Pont. La rivière coule
de la gauche vers la droite. La cascade du Déroc se situe dans une
partie boisée juste au-dessous des forêts de la ligne d'horizon,
au milieu de l'image.
Liste
des pages de PHOTOS
Haut
de page
Page
d'accueil
Page de photos mise à jour le 15 mars 2021