![]()
Photos : page
de photos 4-3
La
nappe de charriage de Gavarnie dans les vallées des Nestes
Des
photos de cette page ont été prises par Philippe Villette à
l'automne 2017. Il a aimablement autorisé l'auteur du site à
les reproduire ici. Elles sont également
visibles dans son site (www.
montagne-pyrenees.info) et dans le site www.scoop.it/t/vallee-d-aure
, où il apporte tous les jours
de multibles informations sur la vallée d'Aure.

CARTE géologique, avec une
COUPE explicative (trés simplifiées), centrées sur le
front de la nappe de charriage de Gavarnie recoupant les vallées
des Nestes de La Géla, de Saux et de Moudang et les chaînons
de direction sud-nord qui les séparent.
Alors que plus au sud le plan de chevauchement de
la nappe sur le "socle" est horizontal, ou même plonge vers
le sud (au niveau de la vallée de Chisagües), il plonge ici
vers le nord : d'où cet aspect en chevrons sur la carte,
qui se voit bien sur le terrain parce qu'il est souligné par le calcaire
dévonien clair (appelé "la dalle" par les géologues)
et par des lambeaux d'ampélites noirâtres.
La "racine" de la nappe de charriage se
situe à peu prés au niveau de la vallée d'Aure (voir
plus loin la géologie de cette vallée).
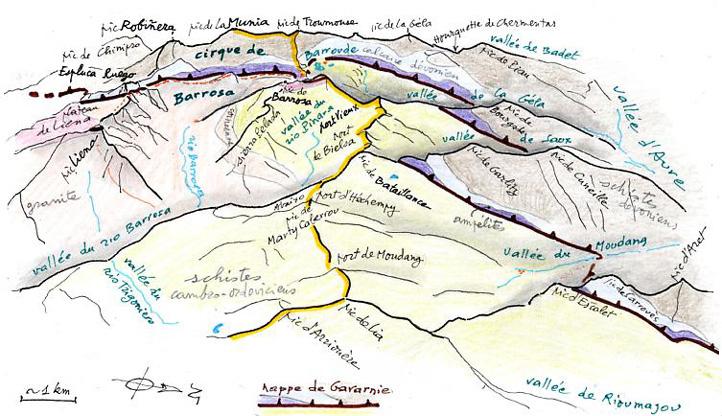
Vue idéale (qui est aussi une carte
géologique), prise de l'est-sud-est, sur la nappe de charriage de
Gavarnie dans la région des Nestes (à droite) et du cirque
de Barrosa (à gauche). On voit que le plan de chevauchement plonge
vers le bas au nord, dans les vallées des Nestes, et au sud dans la
région du plateau de Liena, et qu'il est horizontal dans le cirque
de Barrosa.
Haut
de page

Depuis les abords du sommet du pic
de Bataillence (ou Bataillance), vue vers le nord sur le port de Bataillence,
en bas de l'image, et sur l'arête sud du pic de Garlitz (qui
se cache derrière son avant-sommet), entre la vallée de la Neste
de Saux à gauche et celle de la Neste de Moudang à
droite (pour en savoir plus sur la vallée du Moudang consulter le
site de Jean
Prugent, n° 17 dans la liste des liens).
Il s'agit là du front de la nappe de charriage
de Gavarnie (voir la page consacrée à la nappe
de charriage), avec la même séquence que dans le cirque
de Barrosa (voir un schéma
de la structure géologique du cirque de Barrosa).,
c'est-à-dire de bas en haut :
- ampélites noirâtres du Silurien, qui
forment un sommet secondaire sans nom (2549 m.) ;
- calcaire clair du Dévonien inférieur
(dit "calcaire de la Dalle", qui forme la proue du pic de Pène
Abeillère et dont l'assise plonge des deux côtés vers
le fond des deux vallées, de Saux à gauche et de Moudang à
droite) ;
- et schistes (ou "pélites schisteuses",
avec intercalations de calcaire, de la "formation de Bouneu") du
Dévonien moyen.
Au dessous et au premier plan, des schistes cambro-ordoviciens
du "socle", dont est constitué le pic de Bataillence. De
loin ils ressemblent aux ampélites et, en l'absence de calcaire crétacé
ou de grès rouge en couverture du "socle", le plan de chevauchement
est difficile à repérer de façon
précise (il passe approximativement par le port de Bataillance).

Photo prise de l'arête nord du
pic de Bataillance. On y retrouve à gauche l'arête qui va
du port de Bataillance au pic de Garlitz. A droite : le lac d'Héchempy
et la vallée du Moudang. En raison de son pendage vers le nord,
l'assise de calcaire de la Dalle qui plonge dans la vallée depuis la
Pène Abeillère à gauche, de même qu'à droite
dans le flanc occidental de celle-ci. (photo Philippe Villette)

Le lac d'Héchempy, vu ici de plus près,
orne un replat (sans doute d'origine glaciaire) qui se situe à hauteur
du plan de chevauchement de la nappe de charriage de Gavarnie. Ce replat domine
la haute vallée du Moudang face à son versant occidental où
la barre de calcaire se dédouble dans la face sud-ouest du pic de
Sarrouès, en avant du pic d'Aret. (photo
Philippe Villette)
Haut
de page

Depuis l'arête nord (schistes du Cambro-Ordovicien,)
du pic de Bataillance, vue de nouveau sur le lac d'Héchempy
à une autre époque de l'année (22 août 2004), en
amont d'un verrou glaciaire. Au fond de la vallée du Moudang on aperçoit,
sur un replat, les granges du Moudang.

Cairn du sommet du pic de Bataillance, fait d'un empilement de
plaques de schiste. Vue vers le sud-ouest : au premier plan, la crête
de la sierra Pelada qui monte jusqu'au pic Barrosa à droite
; à l'arrière-plan, la crête du cirque de Barrosa,
du col d'Espluca Ruego à gauche au pic de La Munia à
droite (qui émerge au-dessus du pic Barrosa).

. Du même cairn vue vers le sud-est : au deuxième
plan, le pic de Marty Caberrou (note1)
(2677 m.), ou pico Salcorz pour les espagnols, et ses schistes luisants ;
au troisième plan : les Punta Suelsa (à gauche)
et Fulsa ; tout au fond : le massif du Cotiella.

Sommet du pic Marty Caberrou (2677 m.). Vue vers l'ouest
sur trois plans : la sierra Pelada et le pic Barrosa ; la crête
du cirque de Barrosa, de la punta d'Espluca Ruego à gauche au
pic de Troumouse, en passant par les pics de Robiñera
et de La Munia ; et au loin le massif du Mont-Perdu.
Au premier plan et formant le cairn, les schistes
très délités dits "schistes sombres", ou "schistes
noirs", datés du Cambro-ordovicien (et peut-être du Silurien),
appartenant au "socle". On distingue la surface de chevauchement
de la nappe de Gavarnie dans le cirque de Barrosa.

Toujours du sommet du pic Marty Caberrou, vue au téléobjectif,
par delà la sierra Pelada et la vallée du rio Barrosa, sur la
partie sud du cirque de Barrosa, de la punta d'Espluca Ruego
au pic Robiñera. On distingue plus nettement le plan de chevauchement
de la nappe de Gavarnie entre le col d'Espluca Ruego et le grand pierrier
au pied du Robiñera.
A l'arrière-plan : le massif du Mont-Perdu.
A noter un détail : l'avancée du sommet du gros
éperon (à gauche, au niveau de ce plan) vers la centre du cirque,
ce qu'on voit mal du cirque lui-même.
Haut
de page

Au sud le regard plonge, à gauche, sur les installations
minières de l'Hôpital de Parzan où vient mourir la
sierra Pelada (à droite). Sur la rive droite de la vallée
de Barrosa se déploie la longue arête nord-est du pic Liena
(en haut à droite). Juste au sud de sa partie haute se situent les
mines du versant est du pic, les mines Luisa, à l'apomb, à
peu près, du pic La Mota.
A l'arrière-plan : les Parets de Pinède.
Haut
de page

PHOTO prise des abords du port d'Héchempy.
Au premier plan, le socle d'un des pylônes du
câble aérien transfrontalier qui transportait le minerai
de plomb argentifère de l'Hôpital de Parzan en Espagne au Pont
du Moudang en France. Le pylône lui-même a sans doute été
abattu par la neige.
La photo montre le flanc est (versant Moudang) du massif
du pic Garlitz , où on voit la bande de calcaire dévonien
clair descendre vers le fond de la vallée à partir du pic
de Pène Abeillère, au-dessus de celle d'ampélite
noirâtre (le port de Bataillence est à gauche, au pied du sommet
de celle-ci.)

Entre la station d'angle, à
hauteur des granges de Moudang, et le port d'Héchempy, il reste quelques
pylônes debout, dont celui-ci, au bord du sentier qui monte des granges
au lac d'Héchempy, à 2100 m. d'altitude.
A l'arrière-plan : le flanc oriental de la vallée
de Moudang, sous les pics de Sarrouès à gauche et de
l'Escalet à droite.
(Remerciements à l'auteur de la photo, Gilles Athier,
pour avoir autorisé sa reproduction ; son blog [curiositespyrenees.blogspot.fr]
contient de nombreuses autres belles photos des mines de Liena et du cirque
de Barrosa, ainsi que d'autres curiosités ou mines des Pyrénées).
(Pour cannaître en détail
le câble transpyrénéen dans la vallée du Moudang
; consulter dans la site
de Jean Prugent la partie qui lui est consacrée).

PHOTO prise du port d'Héchempy,
ou port de Salcorz (plus précisément de la tranchée dans
laquelle le câble aérien franchissait la crête, 250 mètres
environ à l'ouest du col), montrant le massif des pics de Sarrouès
et (en arrière de celui-ci) d'Aret, qui forme le flanc est
de la vallée du Moudang. Au fond de la vallée on devine
les granges du Moudang sur leur pâturage.
Sur cette photo se voit nettement
le front de la nappe de charriage, souligné par des bandes
de calcaire dévonien clair plongeant au nord vers le fond de la
vallée.

PHOTO prise au téléobjectif,
du sommet du pic de La Munia, sur ce même flanc est de la vallée
du Moudang. Le pic d'Aret (2939 m.) est presque au milieu de l'image.
Le pic de Sarrouès (2826 m.) est à droite : on voit bien
dans son versant sud-ouest les couches de calcaire du Dévonien inférieur
(dit "calcaire de La dalle") alternant avec des couches de schistes
et inclinées vers le fond de la vallée du Moudang.
Dans l'angle inférieur gauche on voit l'arête
sud du pic de Garlitz (marron clair), et son épaulement, le pic
de Pène Abeillère (2611 m.), constitué, de
l'autre côté de la vallée du Moudang, par ce même
calcaire dévonien. (photo André Gomez).

PHOTO prise du col de Baricave. Vue vers l'ouest sur
le versant est du pic de Sarrouès dans lequel on retrouve la
même disposition : ampélite en bas (dont la couche s'interrompt
ici en allant vers le nord, à droite), calcaire dévonien (couche
épaisse au-dessus du col à gauche), schistes de la "formation
de Bouneu" en haut (photo.Philippe Villette)
Haut
de page

La vallée de Saux dans sa partie moyenne, dont
le replat (au-dessus du tunnel Aragnouet-Bielsa) est dominé par la
retombée, dans son flanc occidental, des deux barres, calcaire claire
et ampélitique noire. (photo Philippe Villette)

Dans la partie haute de la vallée de Saux, se
retrouve, dans son flanc occidental, comme dans la vallée du Moudang,
la même succession : pic Garlitz schisteux, Pène Abeillère
calcaire, couche d'ampélite noire (les cônes d'éboulis
sont issus de la barre calcaire) et soubassement de schistes ardoisiers
ou bleus cambro-ordoviciens. Le plan de chevauchement de la nappe de charriage
de Gavarnie, à la base de la couche d'ampélite n'est pas nettement
repérable. (photo Philippe Villette)

Tout en haut de la vallée de Saux, du sentier
du port de Bataillance (à droite), vue sur, de gauche à
droite, le pic Garlitz (ou son avant-sommet), le Pène Abeillère
blanc, et le pic sans-nom noir.

Contraste entre le Pène Abeillère
blanc et la couche sous-jacente d'ampélite noire. (photo
Philippe Villette)

Vue vers l'est, des bords d'un laquet
de la partie haute de la vallée de Saux, sur le sommet sans nom (2549
m.) qui se situe entre le Pène Abeillère (dont l'éperon
est visible à gauche) et le port de Bataillance. Il est entièrement
constitué d'ampélite. Le laquet se situe, comme le lac d'Héchempy,
à peu près à hauteur du plan de chevauchement (masqué
par les éboulis) de la nappe de Gavrnie sur lequel repose ce sommet
secondaire. (photo Philippe Villette)

Photo prise le 8 juin 2005 près du port d'Héchempy,
versant Aragon. Identification de l'oiseau : incertaine pour l'auteur du site
; peut-être un Tarier pâtre femelle.
Haut
de page
*
Géologie de la vallée d'Aure

Cette carte géologique simplifiée
(et dont les couleurs se rapprochent des couleurs conventionnelles) situe
la région de la vallée des Nestes (en bas à gauche) dans
la région plus large de la vallée d'Aure et de celle du Louron,
et dans la structure des Pyrénées (voir dans l'image suivante
une coupe géologique qui peut servir de légende à cette
carte).

Coupe géologique
schématique du versant nord des Pyrénées centrales au
méridien approximatif de la rive droite de la vallée d'Aure.
A propos de la Faille
Nord-Pyrénéenne (F.N.P.), qui fait la limite entre les plaques
ibérique et européenne : sa localisation précise
ne fait pas l'unanimité, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une faille
unique mais d'une "famille" de failles ; on la situe :
- soit, comme ici dans la carte et la coupe, au contact
entre l'écaille des calcaires du
Crétacé supérieur (en vert) et, au nord, la Zone Interne
Métamorphique (rayures);
- soit au contact (discordant) entre ces calcaires du Crétacé
supérieur et, au sud, les grès rouges du Permo-Trias (en rouge)
qui constituent la couverture des terrains paléozoïques de la
haute chaîne axiale primaire.
(Pour voir une CARTE interactive des vallées
d'Aure et du Louron aller dans une des pages du site
du Pays des Nestes.)
Haut
de page
*
Géologie de la
région des lacs de Miares

Montage de photos de la région
des LACS DE MIARES (ou Miarès ?), associées à
une carte géologique et à des calques interprétatifs.
La nappe de Gavarnie s'étend vers l'est à
peu près jusqu'au méridien de Luchon (et même peut-être
jusqu'à la vallée d'Artiga de Lin). Sa limite méridionale
de chevauchement se repère en particulier dans cette région
de lacs de Miares (plus d'un km à l'est du cirque de Barrosa, à
peu près sur le méridien du col d'Azet) où on trouve
sur l'arête sud du pic de Sarrouyes, dite "crête de Bassiouente",
une configuration géologique comparable à celle du port de Barroude.
La photo
1 montre cette crête
vue de l'est : on y voit à droite (nord) la nappe de Gavarnie faite
de terrains paléozoïques, dévoniens inférieurs
en haut (principement des calcaires rubanés sombres), siluriens à
sa base (ampélites), et à gauche (sud) le "socle"
constitué de roches cambro-ordoviciennes (schistes au sens large)
sous une couverture discontinue faite de roches rouges du Permo-Trias
(conglomérat) et de calcaire blanc ou jaunâtre du Crétacé
supérieur.
Les photos 2 et 3 montrent la partie sud de
cette couverture, vue de l'est sur la photo 2, du nord sur la photo 3 où
on la voit au premier plan et au deuxième plan sous la forme d'une
bande oblique de calcaire blanc à droite d'une masse de roche sombre
rougeâtre silurienne (ampélite).
La photo 4 montre, vu du sud,
au deuxième plan l'épaulement de l'arête sud du pic Srrouyes,
taillé dans le calcaire sombre du dévonien inférieur,
et au premier plan le calcaire clair du Crétacé supérieur
juste au sud du chevauchement.
La photo 5 montre un banc de grès rouge, sous
la forme d'un conglomérat du Permo-Trias au-dessus des schistes cambro-ordoviciens
et au-dessous du calcaire crétacé.
Liste
des pages de PHOTOS
Haut
de page
Page
d'accueil
NOTES
1. C'est le nom qui lui est donné sur la carte IGN. Selon Emile Belloc (dans son livre De la vallée d'Aure à Gavarnie par le Nord de l'Espagne, édité en 1902, en note à la page 20) le nom qui convient serait celui d'un certain Martin Cabero. Cabero signifie en espagnol faiseur de manches d'outils. Donc Martin et pas Marty, et Cabero et non Caberrou, qui vient de ce que sur le versant français on transforme le son o en son ou. Pour certains cabero voudrait dire petite tête d'ours (?).
Page de photos mise à jour le 3 juillet 2020