![]()
Photos
: page de photos 10-15
La tour
de Lieussaube
La tour de Lieussaube
ne se situe pas dans le cirque de Barrosa, ni dans la région de Barroude,
mais de l'autre côté de la crête du cirque de Troumouse,
à l'extrémité nord de celui-ci.
Elle se dresse au-dessus de la vallée d'Héas,
dans son axe, détachée de la falaise qui ceinture la base du
flanc sud-ouest du pic de la Sède, un peu au-dessus du plan de chevauchement
de la nappe de charriage de Gavarnie.
Mais
les roches qui la constituent et son environnement géologique sont
les mêmes que ceux qu'on trouve dans le cirque de Barrosa ou dans la
muraille de Barroude (voir une coupe
géologique).
En outre il s'agit d'un beau site, curieux, qui, complétant
celle du cirque de Troumouse, mérite une visite même si on ne
s'intéresse pas à la géologie (note
1).

La CARTE localise
la tour de Lieussaube dans le cirque de Troumouse : à son extrémité
nord, à l'Ouest du pic de la Sède, au pied de la falaise qui
ceinture la base du flanc sud-ouest de celui-ci, un peu au-dessus du plan
de chevauchement (ligne brune dentelée) de la nappe de charriage de
Gavarnie (en brun clair) sur le socle paléozoïque.
Le cadre correspond à la carte topographique ci-dessous
Figure sur cette carte le sentier
par lequel on peut monter à la tour de Lieussaube par la vallée
de l'Aguila : 500 m. en amont de la chapelle
d'Héas, à
150 m. de la route, il quitte le sentier
du cirque de Troumouse (dénivelé : 700 m.). C'est le sentier
de la Hourquette d'Héas : il faut le quitter un peu au-dessus du replat
et de la cabane de L'Aguila.
Ensuite le sentier mène au pied de la tour, dont l'ascension est facile
par son arête sud.
Le dénivelé entre Héas (1550m.) et
le sommet de la tour (2194 m.) est de 644 m.
Le retour peut se faire soit directement par la cabane
des Aires et le sentier du ravin des Touyères, soit, après la
traversée du cirque, par le sentier qui, à 500 du parking quitte
la route de celui-ci pour descendre à Héas
par l'Hôtellerie du Maillet en recoupant
ses lacets, (note 1).
La carte au 1/25000 de l'IGN à
utiliser sur le terrain est celle de Gavarnie, 1748 OT
La PHOTO montre la tour de Lieussaube vue du nord,
avec en toile de fond les falaises du cirque de Troumouse, principalement
le pic de La Munia.
 |
Carte
localisant le cirque de Troumouse sur le plan géologique.
C'est la carte de la "fenêtre" Gavarnie-Héas créée dans la nappe de charriage de Gavarnie par le creusement, par érosion glaciaire, des vallées des gaves de Pau et de Héas. Dans ces vallées elle découvre le socle métamorphique et plutonique sous-jacent. L'extrémité est de cette "fenêtre" (cadre rouge), en amont d'Héas, se situe dans le cirque de Troumouse. Plus à l'est l'érosion glaciaire a creusé les cirques de Barroude et de Barrosa |


La carte et la coupe
géologique (entre port de la Canau au Sud-Sud-Est et Fourche de la
Sède au Nord-Nord-Est) à ci-dessus (complétées
par un petit glossaire dans la note 2
) de la région de la tour de Lieussaube, visent à
préciser sa constitution et sa situation géologiques
(le dessin précisant en outre ses dimensions), à savoir
:
- la
tour se situe un peu au-dessus du plan de chevauchement (trait marron dentelé),
proche de l'horizontale, de la nappe de charriage de Gavarnie sur le
socle, ici essentiellement constitué de roches paléozoïques
dures, des migmatites ;
- comme
la falaise de la fourche de la Sède, la tour est constituée
d'un calcaire daté du Dévonien inférieur (plus
précisément de "calcschistes" qui, à la base
du "calcaire de la dalle, reposent sur une couche de "pélites
sombres" plus friables) ;
- au-dessous se situe la "semelle" de la nappe
de charriage, constituée d'ampélites, datés du
Silurien vers - 450 à - 400 Ma (voir certaines des photos ci-dessous).
(Cliquer sur l'image pour voir une carte géologique
de l'ensemble du cirque de Troumouse et de la vallée de l'Aguila)
Il est probable que la tour (voir la
photo ci-dessous) :
- s'est détachée de la falaise
qui ceinture la base de la fourche de la Sède (peut-être à
la faveur d'une grande diaclase (comme c'est le cas pour les gros blocs de
calcaire qu'on trouve au pied des falaises de calcaire de "la dalle"
de la muraille de Barroude, en particulier, ou sur la moraine du cirque de
Barrosa) comme le suggère la similitude de profil de son bord nord
et de la morphologie de la base de la falaise;
- puis a glissé d'une centaine de mètres
environ vers le bas, sur la pente, au pied de la falaise, glissement peut-être
favorisé par les roches friables sous-jacentes, en partculier les
"pélites sombres", mais peut-être aussi les
ampélites (dont l'apparence, le "faciès", n'est
pas très différente de celle de ces pélites), et
qui, présentes au sud de la tour, se prolongent peut-être
jusque au-dessous de celle-ci. Grâce à leur contenu en graphite,
ces ampélites ont pu jouer ici leur rôle de "couche-savon"
et favoriser le glissement de la tour, comme ailleurs celui des nappes de
charriage (note
3)..

Sur
cette photo on voit bien, en haut à droite, au-dessus d'un éboulis
clair, l'échancrure qui a pu être creusée dans
la falaise par le détachement de la tour, et en bas à gauche,
un éboulis qui trahit la présence, sous la tour, de la couche
d'ampélite qui a pu, avec la couche de pélites sombres,
friables, qui la surmontent, favoriser son glissement.
.
La tour de Lieussaube vue de la vallée d'Héas

Depuis l'éboulis de l'Araillé (carrefour
des routes d'Héas et du barrage des Gloriettes), vue vers l'est, le
soir. Au fond, à droite, le cirque de Troumouse. A gauche, la
falaise qui ceinture la base du flanc sud-ouest du pic de la Sède.
Au-dessous de l'extrémité sud de cette falaise, à haureur
des falaises du cirque, la petite pyramide sombre est la tour de Lieussaube.

Vue analogue, depuis l'ancienne grange
dite Ets Penaous, où on voit bien que la tour de Lieussaube
est détachée de la falaise.

Peu avant d'arriver à Héas
(dont on devine sa chapelle), vue plus large sur le pic de La Sède
(2694 m.), et, dans le fond, sur le cirque de Troumouse, avec,
à droite, le pic de La Munia.

Ancienne carte postale reproduisant (par
une phototypie des frères Labouche de Toulouse) une photo de la
vallée d'Héas où on voit, sur le versant droit
de celle-ci, la tour de Lieussaube à hauteur de la crête
du cirque de Troumouse.
A gauche, le village de Héas. On devine au loin la
chapelle.
(image extraite de l'un ou l'autre des sites :
loucrup65
(recherche : Héas) ; sites.google.com
(sélectionner : 08-Gèdre) ; archivesenligne65
(Archives en ligne > Accès par type de documents > carte postale
>recherche : Héas)

Au téléobjectif, vue sur la
tour de Lieussaube, au pied de l'extrémité sud de la
falaise. A droite, la paroi du cirque de Troumouse.
A noter, au-dessous de la tour, des éboulis noirâtres
qu'on peut mettre en relation avec la présence d'une couche de "pélites
sombres" friables, et peut-être aussi d'ampélites,
c'est-à-dire de ce type de schiste, également friable, daté
du Silurien (en gros 450 à 400 millions d'années [Ma]), riche
en matières organiques sous fome de graphite (note
2).
Haut
de page
Montée
vers la tour de Lieussaube par la vallée de l'Aguila

Soleil matinal, entre deux plafonds
nuageux, sur le Mounherran, à droite (2783 m.). Vers la gauche,
dans l'ombre : les pics d'Estaubé, le Soum de Port Bieil,
le pic (pointu) de Gabiédou, le port de la Canau et le
pic de Bouneu.

Le ruisseau de l'Aguila (origine
du nom : l'aigle). Au fond, ensolleillé, le Mounherran
(à gauche) et le petit Gabiédou (arête nord-ouest
du Mounherran appelée Chourrugue).
Au premier plan, à gauche, au bord du ruisseau, la roche
claire est du granite. Elle englobe une enclave de roche sombre (bien
que voisine du granite), qui est de la diorite dont est issu, par fusion
partiele, ce granite (note 1 et 2).

Sur le bord du ruisseau de l'Aguila, un
aperçu sur les migmatites, où se mélangent, comprimées,
des lits irréguliers clairs, de composition granitique (quartz et feldspath),
résultant de la fusion partielle d'une roche originelle, et les lits
sombres de cette dernière ayant échappé à la fusion
(note 2).

En diagonale de l'image : le Sarrat
de Terre Arrouye, qui est en gros l'arête sud-ouest du massif du
Soum des Salettes (ou pic des Aguilous) dont le versant sud constitue le flanc
nord de la vallée de l'Aguila.
On voit sur cette arête l'étagement géologique
typique de la région Troumouse-Barroude-Barrosa, de bas en haut :
- les roches du socle paléozoïque (dominant
à gauche la vallée d'Héas), constitué de diorite
en bas, de migmatites en haut (couvertes par endroits d'une mince couche
peu visible de calcaire du Crétacé supérieur),
le bord du socle correspondant au plan de chevauchement de la nappe de
Gavarnie ;
- la couche d'ampélites noirâtres et friables
(d'où sa faible pente), datées du Silurien, qui forme plus loin,
au nord-ouest, le "balcon" de la "Montagne" (pâturages)
de Camplong, (voir la photo suivante et d'autres plus loin). L'ampélite
(ou schiste silurien ; voir la page
qui lui est consacrée) n'a pas un aspect attrayant. Pourtant elle
a un rôle fondamental dans la formation des montagnes. En effet, en
raison de cette friabilité et de son contenu en graphite, elle favorise
le décollemnt puis le glissement (effet lubrifiant, d'où le
nom de "couche-savon"), donc le chevauchement, des nappes de
charriage (ici celle dite "de Gavarnie") dont l'empilement est
à l'origine des chaînes de montagne par affrontement de continents.
C'est pourquoi on la trouve au niveau de la "semelle" de ces nappes,
où elle induit le plus souvent de faibles pentes, couvertes, comme
ici dans la vallée d'Héas, de pâturages.
- les roches du Dévonien inférieur et moyen :
calcaire clair de "la dalle" et "formation du Bouneu"
(pélites schisteuses) (note 1).

Photo de l'extrémité sud-Est de la "Montagne
de Camplong" où, dans ses faibles pentes, affleurent largement
les ampélites constituant la semelle de la nappe de Gavarnie, laquelle
repose sur le socle de migmatites claires que l'érosion a modelé
à deux reprises, une première fois au Permo-Trias pour former
la pénéplaine post-hercynienne quasi horizontale, une deuxième
fois à l'ère quaternaire dont les glaciers ont creuseé
la vallée d'Héas en taillant ses flancs abrupts.
Haut
de page

Sur le replat de l'Aguila, au bord
du ruisseau, un bloc de marbre stratifié, tombé de la
falaise de calcaire de "la dalle" qui surplombe le flanc sud de
la vallée de l'Aguila). Ce calcaire a été en effet métamorphisé
(recristallisé) par endroits en marbre sous l'effet de la chaleur lors
de la formation de la chaîne hercynienne.

Entre le replat de l'Aguila et la
tour de Lieussaube, le sentier (qui se détache de celui de la Hourquette
d'Héas) est balisé par des cairns qui incluent des blocs
de marbre.

La montée vers la tour de Lieussaube se fait face
au vaste versant sud du Soum des Salettes (ou pic des Aguilous; 2976 m.),
dans lequel s'étagent, au-dessus de la cabane de l'Aguila (dans l'ombre),
de bas en haut : la couche d'ampélites siluriennes ; celle de calcaire
de "la dalle" du Dévonien inférieur (en bas, à
gauche de l'image, à la limite de l'ombre ; on la retrouve en haut,
à droite) ; la formation du Bouneu du Dévonien moyen
; le tout couronné par une couche de calcaires (dits "calcaires
gris et calcaires rubanés") colorés en orange sous
cet éclairage matinal, du Dévonien moyen (à supérieur
; voir une page
où il est question de ce type de calcaire du col de Robiñera).
Au premier plan : des calcschistes.(note
2).
La tour de Lieussaube et le cirque de Troumouse

Lorsque le sentier atteint un petit
plateau herbeux à la base de la falaise de la Fourche de La Sède,
on découvre la tour de Lieussaube (massive : environ 50 m. de
haut pour 60 m. de large), qui se détache sur le cirque de Troumouse
en toile de fond. Distante d'une centaine de mètres de la falaise qui
la surplombe, elle constitue avec celle-ci la grande "porte
d'entée" du cirque de Troumouse quand on l'aborde par le nord,
à partir de la valée de l'Aguila
.

Autre photo de la tour de Lieussaube prise au début
de l'été, plus tard dans la journée, avec en toile de
fond la paroi du cirque de Troumouse : de gauche à droite le pic
de La Munia, le Mont Arrouy, le col de la Clé du curé et
la Pène Blanque.
Au pied de la paroi, vert foncé, le dôme central
du cirque, culminant au Cot, constitué, sur le plan géologique,
de diorite.

La tour de Lieussaube, là
aussi vue du nord mais de plus près. Comme la base de la falaise elle
est constituée de calcaire ou de calcschiste (calcaire stratifié
se débitant comme un schiste, visible dans l'angle inférieur
gauche de l'image) de la base de la couche de calcaire de "la dalle"
du Dévonien inférieur.
Comme son bord nord-est épouse la base de la falaise on
peut supposer que la tour s'est détachée de la falaise puis
a glissé vers le sud-ouest d'une centaine de mètres (note
1). A noter au-dessous d'elle, dans l'ombre mais quand même
visibles (mieux visibles sur la photo précédente), des éboulis
noirâtres témoignant peut-être de la présence là
d'ampélites siluriennes qui ont pu, associées à
des pélites sombres sus-jacentes, favoriser ce glissement.

Autre vue, du nord, de la tour de Lieussaube se détachant
sur les falaises du cirque de Troumouse : de gauche à droite,
le pic de Serre Mourène, La Munia (3133 m.), le col
de La Munia, le Mont Arrouy et la Pène Blanque.
Au sommet de la tour pointent, à gauche le bloc sommital
de la barre de son bord nord-est, à droite le cairn de son extémité
ouest (voir des photos ci-dessous).

Avant d'arriver au pied de la tour
on traverse, au pied de la falaise, en haut d'un couloir abrupt, un éboulis
dont les blocs de calcaire, tombés de la base de la couche de calcaire
dit de "la dalle", sont fortement et nettement plissés.
On voit, à droite, la coupe d'un pli, et au milieu de l'image, à
la fois la coupe et une trentaine de cm de la convexité de la charnière
d'un autre. (note 1).

Le magnifique double pli bien visible dans l'autre
face du bloc qui figure à droite sur l'image précédente.

Vue d'ensemble de la région de la tour de Lieussaube
depuis le centre du cirque de Troumouse (petit massif du Cot). La tour se
projette sur une falaise tranchée dans la base de la branche sud de
la Fourche de la Sède (en haut à droite de l'image).
A l'arrière-plan : le Soum des Salettes, ou
pic des Aguilous, dont on voit son arête ouest, avec son prolongement
sud-ouest dit "Sarrat deTerre Arrouye".
A mi-hauteur de l'image une ligne horizontale se dessine,
allant de la base d'un affleurement noirâtre (au pied du Sarrat de Terre
Arrouye) à la base d'un autre affleurement noirâtre (au pied
de pelouses dont le soleil souligne la couleur), en passant au-dessous de
la tour. Il s'agit d'affleurements de schistes noirs, appelés aussi
"ampélites", et cette ligne correspond à la
surface de chevauchement de la nappe de Gavarnie (en haut ) sur le
socle métamorphique (voir plus loin)

Laa tour de Lieussaube, vue
là aussi du Cot (au centre du cirque de Troumouse), donc du sud : elle
donne l'impression de sortir de la large échancrure de la grande falaise
taillée dans le calcaire dévonien clair, dit de "la dalle",
au bas de la branche sud de la Fourche de La Sède (on traverse
cette couche de calcaire quand on monte, depuis le cirque, au col de
la Sède qui se situe hors de l'image à droite).
A droite de la tour, donc plus au sud, on voit, au bas de
pentes herbeuses, des affleurements d'ampélites, juste au-dessus d'une
accentuation de la pente constituée de roches claires qui sont des
migmatites (c'est à ce niveau que se situe le plan de chevauchement
de la nappe de Gavarnie sur le socle métamorphique constitué
ici par ces migmatites). Ces affleurements sont au même niveau que les
roches sombres visibles au-dessous de la tour.
A l'arrière-plan : le sommet du Soum des Salettes
(ou pic des Aguilous).

Vue plus rapprochée, du sud-ouest,
sur la tour de Lieussaube et la falaise qui la
domine, taillée dans la "Fourche de La Séde".
La large échancrure claire de la falaise renforce l'hypothèse
selon laquelle la tour se serait détachée de cette falaise,
puis aurait glissé vers le bas, glissemnt favorisé probablement
par des "pélites sombres", et peut-être aussi par des
ampélites sous-jacentes (voir la première image et la
note 3 ).
On voit nettement au-dessous de la tour le long éboulis
violet foncé, dont la couleur évoque celle d'éboulis
issus d' ampélites.
A gauche, le haut du couloir caillouteux, raide, en entonnoir,
qui descend de la falaise.

Autre vue, depuis le sud, sur la tour
de Lieussaube (et la petite crête qui la prolonge à droite)
dominant les pelouses illuminées par le soleil matinal.
On voit bien son sommet : une surface herbeuse inclinée
vers la droite (est) et limitée, côté falaise, par un
mur calcaire.

Autre vue du sud-ouest sur la
tour de Lieussaube, depuis l'hôtellerie
du Maillet, au coucher du soleil.

Vue sur les roches qui se situent
à la base de la tour de Lieussaube (à droite). Elles forment
en particulier (à gauche) une crête déchiquetée
qui se distingue par sa couleur noirâtre.

La tour de Lieussaube, en haut à
droite de l'image, se détache sur la falaise de calcaire clair dit
"de la dalle".
A ses pieds, au premier plan, des affleuremts rocheux prennent
un aspect évoquant des ampélites.
.

Autre affleurement dans un éperon;
situé sous la tour, égalemnt évocateur d'une ampélite.

Ce même affleurement vu
de plus près : une roche noire, finement schisteuse, friable,
présentant donc des caractères qui sont bien ceux des ampélites.
L'instabilité, bien visible sur ce cliché,
de cette roche, située sous la tour, rend vraisemblable l'hypothèse
d'un facteur favorisant des ampélites dans le glissement vers
le bas de la tour de Lieussaube, comme ailleurs à la base de la nappe
de Gavarnie.

Depuis l'ancienne cabane des Aires (où les
bergers ont plusieurs fois hébergé Lucien Briet : voir les
dernières images de la page consacrée à l'ascension du
pic Gerbats), vue sur la
tour de Lieussaube, au loin : elle se détache sur la crête de
"Sarrat de Terre Arrouye" (qui prolonge l'arête sud du Soum
des Salettes), éclairée par le soleil matinal.

Vue comparable, avec au premier plan un lapiaz de calcaire.
Il s'agit d'un affleurement du calcaire daté du Crétacé
supérieur qui constitue (avec, ailleurs, du grès rouge du
Permo-Trias) la couverture du socle métamorphique sur lequel repose
la nappe de Gavarnie.

Autre vue de la tour de Lieussaube, depuis les pelouses
du cirque de Troumouse qui s'étendent, dans sa partie nord, entre la
Fouche de La Sède et le ravin des Touyères (qu'on devine à
gauche).
A l'arrière-plan : les massifs du Vignemale
(à gauche) et de l'Ardiden.

La tour de Lieussaube (à gauche) vue du
sud-est, et la base de la falaise (à droite) dont elle s'est probablement
détachée, séparées par un éboulis de roches
claires tombées de cette falaise calcaire. L'ensemble se projette sur
le versant sud du Soum des Salettes à l'arrière-plan.
Le sommet de la tour est une surface plane, mi-rocheuse, mi-herbeuse,
inclinée vers le sud-est et ainsi de plain-pied, au sud, avec un collet,
facilement accessible, qui la sépare d'un petit môle rocheux
moins haut (en avant de la tour sur l'image).
On atteint ainsi facilement (il y
a même un sentier) le cairn que porte l'arête nord à son
extrémité ouest, et la barre qui surmonte de quelques mètres
l'arête nord-est.
On voit au premier plan des affleurements d'ampélites
noirâtres.

Les abords de la tour sont
parsemés de blocs rocheux, plus ou moins volumineux, de même
nature que la falaise dont ils sont tombés.

La tour vue aussi du sud-est, mais
de plus loin. On voit bien le collet qui la sépare d'un petit môle
rocheux, à gauche, et l'obliquité de sa surface sommitale.
A gauche, à peu près à la même
hauteur mais de l'autre côté de la vallée d'Héas,
on distingue, sous l'arête nord-ouest (dite Chourrugue) du Mounherran
et au-dessus de la Montagne de Poueyboucou, la couche horizontale claire
de calcaire dévonien, dit de "la dalle", qui se prolonge
plus loin dans le flanc nord-est du pic de Larrue.

, Depuis les abords de la tour, vue vers le nord-ouest, sur la
vallée d'Héas, typiquement glaciaire, en auge (ou en
U). Elle est bordée par quatre "balcons", faiblement
inclinés, de part et d'autre : deux rive gauche (sur lesquels s'étalent,
au pied de la barre de calcaire, les pâturages, appelés "Montagnes",
de Poueyboucou sous le Mounherran, et, au-delà de la vallée
d'Estaubé, de Coumély, sous le pic Larrue (au nord du Piméné,
en haut à gauche) ; et deux rive droite : les pentes herbeuse du premier
plan, et plus loin, la longue "Montagne" de Camplong où les
affleurements d'ampélites sont bien visibles).
Ces balcons, dont les ampélites friables expliquent la
faible pente, constituent la base de la nappe de charriage de Gavarnie. L'érosion
a creusé dans celle-ci une "fenêtre", et dans
dans les migmatites du socle paléozoïque sous-jacent, la vallée
d'Héas aux flancs abrupts. Le bord de ces "balcons" correspond
à la surface de chevauchement de la nappe de Gavarnie.

Dans l'axe de la vallée d'Héas, le cairn
dressé à l'extrémité ouest de la tour (dont on
voit l'ombre à droite). On voit bien, rive droite, la "Montagne"
de Camplong.

Le gros bloc sommital posé à l'extrémité
de la barre rocheuse qui surmonte de quelques mètres le versant nord-est
de la tour, constitué lui aussi de calcschiste (calcaire stratifié
se débitant comme un schiste).
A gauche du bloc on voit, au loin, le cairn, et la pente
herbeuse par laquelle on atteint facilement cette barre.
Y monter implique
une courte escalade (II à III) ; se percher sur le bloc est plus difficile
(III à IV).

Vue générale de l'extrémité
nord du cirque de Troumouse. La tour est en haut à droite. Au premier
plan, les grands pâturages du nord du cirque de Troumouse.
A gauche : la vallée d'Héas, et sur sa rive
gauche les balcons sur lesquels s'étalent les "Montagnes"
(c'est-à-dire les pâturages), de Poueyboucou et plus loin de
Coumély (sous le pic Larrue).
Au fond : les massifs du Vignemale à gauche,
et de l'Ardiden à droite.

Vue rapprochée sur les affleurements
d'ampélites, alignés dans la pelouse au sud-est de la tour.
Ils se prolongent peut-être plus loin, au même niveau, donc au-dessous
de celle-ci.

Dans les pelouses, plus au sud et
à peu près au même niveau: d'autres affleurements d'ampélites.

Un autre affleurement d'ampélites,
au premier plan, à proximité d'un enclos, en accord avec la
vocation pastorale de ces vastes pelouses qui doivent leur faible pente à
la présence de l'ampélite.
A gauche : l'arête nord-ouest du Mounherran, appelée
Chourrugue, au-dessus de la couche de calcaire dévonien clair
de "la dalle".

Ruines d'une cabane qui, avec l'enclos égalemnt
proche de la tour de Lieussaube (et un autre dans une large anfractuosité
rocheuse au-dessous de celle-ci) faisait partie d'un "coueyla",
dit "coueyla de Lieussaube". C'est, avec ceux du Cot et celui
des Aires, l'un des trois coueylas du cirque de Troumouse (voir la
page consacrée au pic
Gerbats, en note 5 ).

Le même enclos, avec,
en toile de fond, au-delà du ravin des Touyères, le cirque
de Troumouse tel qu'on le découvre lorsque, venant de la vallée
de l'Aguila, on franchit la "porte d'entrée" de Lieussaube.
Au deuxième plan : son dôme central (partie du socle culminant
au sommet dit "le Cot", à 2138 m.), et, à l'arrière-plan,
ses falaises (du pic d'Arrouye à gauche au Soum de Port Bieil
à droite, en passant par la Pène Blanque, massive, le
pic de Bouneu, le port de La Canau et le pic de Gabiédou,
pointu) (voir les cartes ci-dessous).
 |
Le dôme central du cirque
de Troumouse est plus haut que le reste de son plancher parce qu'il
est, comme le montre cette carte géologique sommaire, constitué
de diorite (en vert sur la carte) (avec en son
centre une petite partie de granite), roche magmatique plutonique intrusive
résistante à l'érosion, alors que, autour de ce
petit massif; le ravin des Touyères et le reste de la vallée
d'Héas (altitude 1520 m. à Héas) ont été
taillés par un glacier quaternaire dans des migmatites, roches
hétérogènes plus tendres. |
Haut
de page

Au centre du cirque de Troumouse,
au bord du sentier qui mène aux lacs et aux cabanes des Aires, ou à
La Munia, moutonnements du massif de diorite (le Cot) poli par
les glaciers quaternaires, avec des stries glaciaires.
A l'arrière-plan : le pic Gerbats et les larges
cannelures taillées dans le calcaire dévonien dit "de la
dalle".

Presque au sommet du massif de
diorite, un affleurement particulier illustre probablement ce qui est
appelé "Une brèche hydraulique" dans le guide
géologique "Hautes Pyrénées" (pages 74-75 et
77-78) (note 1). Le mécanisme
de cette brèche (= amas de blocs rocheux anguleux) y est décrit
comme étant le suivant : un magma de composition granitique
(peu dense), issu en profondeur d'une fusion partielle (anatexie), monte dans
la diorite (dense), en y provoquant une fracturation hydraulique, jusqu'à
la partie supérieure du massif où il finit par cristalliser
en granite (blanc) dans les interstices entre les blocs anguleux de diorite
(gris clair).
Au deuxième plan, dans le flanc droit du ravin des
Touyères, on voit, à gauche, la tour de Lieussaube détachée
de la grande falaise (dans l'ombre) de la base du pic de La Sède.
A l'arrière-plan : le Soum des Salettes (pic des Aguilous).

Autre aspect de la diorite.
Haut
de page

Le versant ouest du pic de
La Munia (au revers du cirque de Barrosa), vu des pelouses du cirque de
Troumouse, avec une moitié supérieure schisteuse (formation
de Bouneu) et un soubassement taillé dans la couche de "calcaire
de la dalle".
La cheminée et le mur par lesquels la voie normale
de La Munia surmonte ce soubassemnt calcaire se situent derrière l'éperon
oblique ensoleillé au centre de l'image.

Cette photo, prise du grand
replat herbeux en amont des lacs de Aires, situe, à l'aplomb du pic
Gerbats, le plan de chevauchement de la nappe de Gavarnie :
entre les ampélites noirâtres et le calcaire blanc (daté
du Crétacé supérieur) représentant, au bord du
replat, la couverture du socle métamorphique (voir ci-dessus la
petite carte géologique de l'ensemble du cirque de Troumouse)..

Vue sur le chemin qui va du parking
à la passerelle principale franchissant le ruisseau du Cot : on y voit,
là aussi, la limite entre les ampélites de la nappe de Gavarnie,
en haut de l'image, et le calcaire crétacé blanc de la couverture
du socle.

Le ruisseau du Cot en aval
de la passerelle qui le franchit non loin du parking, et en amont d'une autre.taille
sa rive gauche dans les ampélites mais sa rive droite longe
les faibles pentes d'un affleurement de calcaire crétacé
blanc. Il coule donc ici au niveau du plan de chevauchement de la nappe
de Gavarnie sur la couverture calcaire du socle métamorphique
Cependant un bloc d'ampélite, à droite, occupe
la rive droite et cette position par rapport au calcaire s'explique mal, si
ce n'est peut-être par l'existence d'une faille, à cet endroit,
de direction nord-sud, qui a pu modifier les rapports entre les roches.

Autre vue sur le ruisseau du
Cot entre calcire crétacé, à gauche, et ampélites.

En aval de la cascade de l'imge précédente,
vue rapprochée sur la limite entre les deux roches : elle semble se
situer là un peu au delà de la rive gauche où on voit
une assise de calcaire.
Le ravin des Touyères

Vue vers le sud-est sur le ravin des Touyères.
Le gave du même nom est issu de la cascade de Matacas, déversoir
des lacs des Aires.
Au premier plan, source d'eau ferrugineuse dans les ampélites.
En toile de fond, les falaises du cirque de Troumouse, avec,
au centre de l'image, la Pène Blanque, à droite du couloir
de la Clé du curé.

Photo plus rapprochée du ravin
des Touyères, dont on voit ici la partie supérieure, avec
la cascade de Matacas dans l'ombre. Dans le coin inférieur droit
de l'image on y distingue le bloc rocheux arrondi appelé "mail
des Touyères" sur la carte IGN (le nom mailh serait plus
juste).
 Vue sur ce bloc, qu'on trouve
ce bloc de calcaire, au fond du ravin des Touyères, entre le
gave (à droite) et le sentier, de quelques mètres de haut, en
plein domaine des migmatites dans lesquelles est creusé le ravin.
Vue sur ce bloc, qu'on trouve
ce bloc de calcaire, au fond du ravin des Touyères, entre le
gave (à droite) et le sentier, de quelques mètres de haut, en
plein domaine des migmatites dans lesquelles est creusé le ravin.
Ce calcaire ressemble à celui de "la dalle"
(Dévonien inférieur) : ce mailh aurait-il glissé depuis
la couche de calcaire de la base du pic de La Sède, comme la tour de
Lieussaube ? A moins qu'il s'agisse plus simplement d'un gros bloc erratique
amené là par un glacier quaternaire (comme celui qu'on trouve
dans la vallée de Barrosa juste en amont de la centrale électrique,
3 km en aval de l'Hôpital de Parzan : voir la page
consacrée aux anciens glaciers du cirque de Barrosa).

Le mailh des Touyères
vu de l'est.

Photo de la sortie du ravin des
Touyères, dominée par les falaises
calcaires dévoniennes du Mounherran.

Lorsqu'on quitte le ravin des Touyères
le sentier traverse le déversoir du raide couloir que surmonte la tour
de Lieussaube, à droite, décollée de la grande
falaise calcaire blanche de laquelle se détachent aussi les blocs
rocheux qui dévalent ce couloir.
Haut
de page
Le vallon du Maillet
et le port de La Canau

Sur la route du cirque, avant les derniers lacets, l'Hôtellerie-refuge
du Maillet (1830 m.), installée sur un replat.
A gauche, escarpements dans les migmatites, surmontés
par le pluton de diorite entaillé par le ruisseau du Cot. En
haut à droite, de gauche à droite (calcaire de "la
dalle" à leur base, formation du Bouneu à leur sommet)
: le pic de Bouneu, le port de La Canau (2686 m., le pic
de Gabiédou, et le Soum de Port Bieil.
Les habitants de la vallée de Gavarnie passaient le
port de La Canau pour se rendre en Espagne dans la vallée de Pineta
et à Bielsa ; les pélerins espagnols le passaient en sens inverse
pour se rendre à la chapelle d'Héas (voir la note 8
de la page consacrée
à la carte Roussel).

Depuis les pâturages la vallée de l'Aguila,
vue sur le port de La Canau (2686 m.), entre, à gauche le pic
de Bouneu (en arrière de son contrefort ; 2726 m.)) et à
droite le pic de Gabiédou (2809 m.). Complètement à
droite : le Soum de Port Vieil (2777 m.).
Chacun de ces deux sommets s'appuie, au nord, sur un énorme
contrefort taillé dans le calcaire massif du Dévonien inférieur
dit "calcaire de la dalle". Les deux contreforts enserrent l'entrée
du couloir qui mène au port et qu'on appele "la Canau". Le
pic du Gabiédou est constitué de calcaires ("calcaires
gris et calcaires rubanés"), du Dévonien moyen, qui lui
donnent cet aspect élancé.

Une autre vue du port de La Canau, prise du bord du cirque
de Troumouse dans sa partie sud, au-dessus du vallon du Maillet, donc de plus
près. Il est encadré par les contreforts nord des pics de
Bouneu, à gauche, et de Gabiédou, à droite.
(photo extraite du livre Les Pyrénées
centrales, de Andrée Martignon et Jean Fourcaccié,
éditions Alpina, Paris, 1946, p.57)
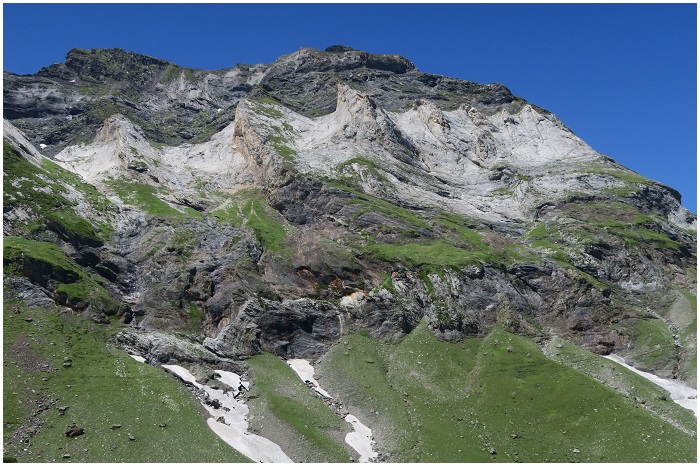
Cette vallée du Maillet est dominée par la
face est du Mounherran (2783 m.), dans laquelle s'étagent les
roches tourmentées composant la nappe de charriage de Gavarnie
(comme dans la falaise nord du cirque de Barrosa : voir la page
consacrée à celle-ci) : à la base, la couche des
ampélites noirâtres siluriennes, au-dessus le calcaire
gris clair de "la dalle" du Dévonien inférieur
(avec les larges cannelures qu'on trouve aussi à l'autre extrémité
du cirque de Troumouse, sous le pic Gerbats), et , sous le sommet, les pélites
schisteuses et le grès de la sombre et plissée formation
du Bouneu du Dévonien moyen.
Haut
de page
La Munia vue d'Héas

La Munia vue de Héas,
le soir, au coucher du soleil (à gauche, le pic de Serre Mourène,
et au fond du V que forment les flancs de la vallée, le haut du Cot,
le dôme central du cirque de Troumouse).
On peut détailler (comme dans le cirque de Barrosa,
de l'autre côté) les diverses assises dévoniennes du pic
de La Munia : de bas en haut, le calcaire clair de "la dalle",
du Dévonien inférieur, les schistes et grès du Dévonien
moyen (formation du Bouneu), et, à hauteur de la crête
sommitale, le grès et les quartzites du Dévonien supérieur
de la série de Sia qui forment le sommet de La Munia à
droite, et le calcaire clair du Dévonien moyen (identique à
celui du Soum des Salettes) qui va du petit pic de La Munia (les deux arêtes
curviligne) au sommet du Serre Mourène à gauche.

Vue plus large, prise également de
la vallée d'Héas, du cirque de Troumouse plus enneigé,
reproduite sur une carte postale ancienne. L'altitude indiquée est
erronée
En bas : le ravin des Touyères, qu'on voit en enfilade
jusqu'à la cascade de Matacas. En haut : les sommets du cirque,
du pic de Troumouse (3085 m.)à gauche, au pic de La Munia
(3033 m.) à droite, en passant par le pic de Serre Mourène
(3090 m.), proche du premier. On distingue, presqu'à l'aplomb
du pic de Serre Mourène, dans les éboulis, les deux petites
aiguilles dites "les deux soeurs".
(image extraite de l'un ou l'autre des sites : loucrup65
(recherche : Héas) ; sites.google.com
(sélectionner : 08-Gèdre) ; archivesenligne65
(Archives en ligne > Accès par type de documents > carte postale
>recherche : Héas).

Vue encore plus large, sur le Gave d'Héas en
aval du hameau d'Héas (qu'on devine à gauche ).
Au fond, la crête du cirque de Troumouse, du pic Heïd
à gauche au pic de La Munia à droite.
(photo extraite du livre Les Pyrénées centrales,
de Andrée Martignon et Jean Fourcaccié, éditions Alpina,
Paris, 1946, p.55)

La Munia vue sous le même angle du sommet
du pic de Cabaliros (le 1er juillet 2019).
On distingue, de gauche à droite : le pic des Aguilous
(ou Soum des Salettes), le pic Gerbats (la dent), le petit pic Blanc,
le pic Heïd, le pic de Troumouse, le pic de Serre Mourène,
La Munia, le Mont Arrouy et la Pène Blanque.
Au premier plan à droite: le haut de la station de
ski de Luz-Ardiden.
VOIR AUSSI, dans le présent
site, au sujet du cirque de Troumouse et de la vallée d'Héas
:
- deux autres pages de photos consacrées à
:
* l'ascension du pic
Gerbats, par le cirque ;
* une randonnée en
boucle à partir d'Héas,
dite circuit
Briet, commençant par la vallée
de l'Aguila et passant par les trois cirques : Barroude, Barrosa et Troumouse,
et par le sommet de La Munia ;
-
une
page consacrée à la carte
Roussel
de la région, mais contenant dans la note 8 des informations
sur la vallée d'Héas.
Retour à la
page générale sur la vallée de La Gela et les vallées
voisines
Haut
de page
la
page contenant la liste des pages de photos
la
page d'accueil du site
NOTES :
 1. L'auteur
du site s'est appuyé, pour visiter et décrire par des photos
commentées la tour de Lieussaube, sur l'excellent guide géologique
Hautes-Pyrénées, de
HERVOUET (Yves), PERE (Alain) et ROSSIER (Dominique),
éditions Omniscience, avec
partenariat du BRGM, 2016.
1. L'auteur
du site s'est appuyé, pour visiter et décrire par des photos
commentées la tour de Lieussaube, sur l'excellent guide géologique
Hautes-Pyrénées, de
HERVOUET (Yves), PERE (Alain) et ROSSIER (Dominique),
éditions Omniscience, avec
partenariat du BRGM, 2016.
Utile aussi bien au montagnard qu'à l'amateur de géologie,
il décrit (sous forme de topo-guides : carte, profil, renseignements
pratiques)
par un texte clair (illustré de nombreuses photos avec schémas
interprétatifs, et de coupes),
de façon précise mais
accessible (il y a un glossaire),
la
géologie des lieux traversés par 10 itinéraires des
Hautes-Pyrénées, en particulier l'itinéraire 3
qui passe par la tour de Lieussaube (La vallée d'Héas
et le cirque de Troumouse : une boucle à partir d'Héas,
avec montée par la vallée de l'Aguila, traversée du cirque,
et descente par l'Hôtellerie du Maillet), mais aussi deux autres itinéraires
dans la région du cirque de Barrosa (1 : Sur la crête
de l'Aiguillette, et 2 : De Piau-Engaly au Port de Barroude).
On trouvera aussi dans ce guide une brève histoire géologique
des Hautes-Pyrénées, et des informations diverses sur les Pyrénées
(flore, faune, thermalisme, mines, etc.).
2.
Petit GLOSSAIRE sommaire des roches rencontrées ou vues du sentier
dans la région de la tour de Lieussaube ; de bas en haut :
- migmatites : roches présentes dans le socle
paléozoïque, dans lesquelles sont mélangés les litts
sombres d'une roche métamorphique et les lits claits irréguliers,
de composition granitique (quartz et feldspath), qui résultent d'une
fusion partielle de cette roche dans les profondeurs de la chaîne hercynienne
;
- diorite : roche magmatique plutonique (ayant cristallisé
sous terre), de composition intermédiaire entre granite et basalte
;
- calcaire du Crétacé supérieur
: calcaire résultant d'un dépot sédimentaire sous-marin,
au Santonien (vers -85 millions d'années [Ma]), sur une plate-forme
peu profonde de l'ancienne chaîne hercynienne aplanie par l'érosion,
et constituant ainsi une mince couverture du socle ;
- ampélites : roche résultant
de sédiments marins, riches en matières organiques, déposés
au Silurien (-450 à - 400 Ma) et transfomés lors de la formation
de la chaîne hercynienne en une vatiété de schiste noirâtre
contenant du graphite responsable de sa friabilité (générant
des reliefs géomorphologiques émoussés), et de son pouvoir
lubrifiant (d'où le nom de "couche-savon") propice au glissement
des nappes de charriage dont l'empilement constitue les chaînes de montagne
par affrontement de continents (voir une page
de photos consacrée aux ampélites);
- pélites sombres : voir calcaire de la dalle
;
- calcaire de "la dalle" :
calcaire massif, clair, souvent métamorphisé (cristallisé
en marbre par la chaleur), daté du Dévonien inférieur
(autour de -400 Ma), constituant, dans la nappe de charriage de Gavarnie,
les grandes falaises des cirques de Barrosa, Barroude et Troumouse ; comportant
parfois une base faite de calcschiste (calcaire stratifié se débitant
comme un schiste) ou de pélites sombres (calcaire friable car
mélangé à des grains argileux très fins d'origine
sédimentaire continentale) ;
- formation du Bouneu : roches datant du Dévonien
moyen se débitant en plaquettes de calcaire gréseux (mélangé
à du sable) alternant avec des bancs de pélites schisteuses
sombres (roche faite de grains très fins provenant d'une érosion
continentale) ;
- série de Sia : roches du Dévonien
supérieur, faites d'une alternance de bancs de grès et de bancs
de quartzite (grès métamorphisé).
3.
 Dans
son livre, Histoires secrètes
de cailloux (
édition Belin, 2021), au chapitre "les
tours Saint-Jacques, un prodige d'équilibre", p. 80, Patrick
De Wever signale, décrit et explique la formation de ces tours, pitons
rocheux comparables à la tour de Lieussaube, mais plus spectaculaires.
Cette curiosité géologique se trouve dans les Alpes,
dans le massif des Bauges,
en Haute-Savoie, au sud-ouest du lac d'Annecy, à l'extrémité
sud de la montagne du Semnoz, au-dessus du village d'Allèves.
Dans
son livre, Histoires secrètes
de cailloux (
édition Belin, 2021), au chapitre "les
tours Saint-Jacques, un prodige d'équilibre", p. 80, Patrick
De Wever signale, décrit et explique la formation de ces tours, pitons
rocheux comparables à la tour de Lieussaube, mais plus spectaculaires.
Cette curiosité géologique se trouve dans les Alpes,
dans le massif des Bauges,
en Haute-Savoie, au sud-ouest du lac d'Annecy, à l'extrémité
sud de la montagne du Semnoz, au-dessus du village d'Allèves.
C'est un groupe de 3 tours, de 80 à 90 m de haut, dont
la plus grosse culmine à 960 mètres d'altitude,
formées d'un calcaire du Crétacé iniférieur datant
de130 à 135 Ma (peu après la fin du Jurasssique). Elles se dressent
sur une pente modérée, consirtuée de marnes, au-dessous
d'une falaise taillée comme les tours dans une épaisse couche
de calcaire du Crétacé inférieur, qui forme le dos de
la montagne du Semno, et repose sur la couche plastique de marnes,
un peu plus ancienne.
Ces gros blocs se sont détachés de cette falaise
et ont commencé à glisser lentemenr, en restant verticales,
sur les marnes friables de cette pente, (qui a fonctionné comme
une couche-savon ; schéma
ci-dessus), à
la vitesse de 2,1 cm par an pour la tour la plus grosse, 1,8 cm pour la tour
du milieu et 4,6 cm pour, la plus basse, la plus rapide. Cette lente glissade
continue actuellement, situant les tours à plusieurs centaines de mètres
de la falaise, 700 m pour la plus haute; 960 pour pour la plus basse et la
plus fine).
Page de photos mise à jour le 2 mai 2024.