![]()
Photos : page
de photos 5-2
Le câble transporteur aérien
des mines du pic Liena
(L'auteur de certaines des photos
de cette page est Jean-Jacques Héran : l'auteur du site le remercie
pour l'avoir autorisé à les y insérer).
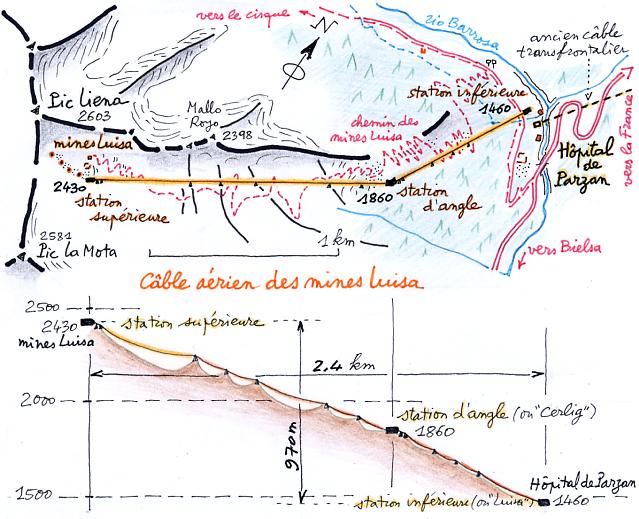
DESSIN précisant la topographie
et l'ampleur du câble aérien transporteur des mines du pic Liena
(plus précisément de celles de son versant est, les mines
Luisa). C'était un monocâble aérien, de type Etcheverry,
par lequel le minerai de fer et surtout de plomb argentifère a
été, entre 1912 et 1928, descendu des mines Luisa (2420 m) aux
installations minières de l'Hôpital de Parzan (1450
m) (voir un plan de ces installations dans la page
qui leur est consacrée).
Ce "système Etcheverry" a été
conçu, comme son nom l'indique, par Hugues-Henry Etcheverry, qui en
a déposé le brevet et a créé, en 1902 à
Paris, la société qui porte ce nom, pour le construire et le
vendre. Sa dénomination change en 1918 pour celle de "Société
de Construction de Voies Aériennes" (note
1)
Le
principe de la fixation des bennes sur le câble était le même
que celui des télébennes des stations de ski actuelles :
une pince débrayable s'ouvrait de façon automatique à
l'entrée des stations (mais se fermait sur le câble sous l'effet
d'une poussée manuelle de la benne) (une
page spéciale
explique ce mécanisme, et il y est question des câbles transporteurs
en général dans une page de photos).
Par rapport au transport du minerai par des caravanes de mulets
ce système était un grand progrés. Le gain de
temps était considérable : il transportait 1 tonne par heure,
à raison de 300 kg par benne, ce qui est la charge transportée
par 2 à 3 mulets.
Il est toujours en place, peu dégradé.
Le
tracé du câble comporte une angulation, et donc une station
d'angle, complexe, assurant ce changement de direction (voir une page
de photos qui lui est consacrée).
La longueur totale du câble, qui était en boucle,
devait être approximativement de 5,5 km.
Sur la carte est figuré le tracé du chemin
des mines Luisa qui permettait autrefois la maintenance du câble,
et actuellement de le voir de près (pour une description de ce chemin,
voir la page consacrée à la course pic
Liena).
*
1.
La station inférieure

PHOTO de la station
inférieure du câble transporteur aérien (dit "câble
Luisa"). On la trouve, noyée dans la végétation,
à droite du chemin du cirque de Barrosa, lorsqu'il tourne vers la gauche
pour quitter ces installations et monter dans la direction du cirque.
Sur la PHOTO on voit surtout le monorail sur lequel les
bennes venaient rouler lorsqu'elles lachaient (automatiquement) le câble
à leur arrivée dans la station, puis, aprés avoir été
déchargées de leur contenu, faisaient demi-tour pour venir s'accrocher
à la partie montante du câble.
Au fond on aperçoit le col frontalier de Salcorz
(ou port d'Héchempy, 2449 m), franchi par un deuxième câble
porteur aérien de 10 km de long, transfrontalier, chargé
de transporter le minerai de plomb argentifère, débarassé
de sa partie stérile dans la laverie, de l'Hôpital de Parzan
au pont du Moudang, en vallée d'Aure (voir la page Mines).
Le SCHEMA (simplifié) montre l'ensemble de la station
et son fonctionnement. Le moteur faisant circuler le câble (en
boucle,) et les bennes, était à la station supérieure.

PHOTO de la station inférieure
montrant une benne qui a été désolidarisée
du câble (qu'on voit monter à gauche, au-dessus des poulies),
et qui a été prise en charge par le rail où elle va faire
demi-tour après avoir été déchargée.

PHOTO ancienne, prise à une
époque où l'envahissement des ruines des installations minières
par la végétation n'empêchait pas de faire une photo de
l'ensemble de la station d'arrivée du câble aérien (remarquer
à droite le haut du plan incliné supportant le chariot de mise
en tension du câble)
(photo de Philippe Vivez, empruntée à son article
paru dans la Revue Pyrénéenne, n°94, 2/2001, Les sentiers
du fer et de l'argent dans les hautes vallées d'Aure et du Cinca).

MONTAGE DE PHOTOS récentes montrant des détails
de la station.
En haut : la partie bâtie et le rail sur lequel les
bennes faisaient demi-tour.
Au milieu : à gauche, une benne venanr d'arriver
dans la station ; à droite, le support de cette benne, posé
sur le rail (il manque le levier qui commandait le fonctionnement de la machoire
par laquelle la benne s'accrochait au câble).
En bas : à gauche, la sortie de la station, où
le rail met les bennes en position de s'accrocher au câble ; à
droite, le chariot (chargé de cailloux) de mise en tension du câble
(on voit le rail incliné sur lequel il roulait sur une des photos
anciennes de la page consacrée aux installations
minières de l'Hôpital de Parzan).

Depuis l'arrêt de la station
en 1928 des bouleaux ont poussé à travers la structure métallique
du chariot, en particulier la grande poulie sur laquelle passe la boucle du
câble (photo de M. Louis de Pazzis : voir les tois dernières
photos de la page).
Haut
de page
*
2.
Les pylônes, le câble et les bennes
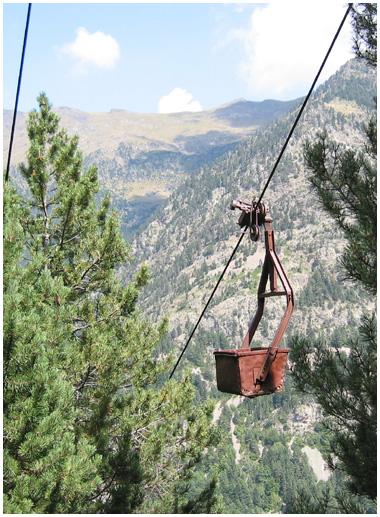
PHOTO d'une benne du
câble aérien,
qui n'a pas bougé depuis 1928, date à laquelle le câble
a cessé de fonctionner. Au fond, le port d'Héchempy (ou
port de Salcorz). Le poids des bennes était : à vide 110 kg,
en charge 385 kg. Leur capacité était de 142 l.

Les
bennes qui descendaient ont encore leur chargement de minerai.

Un des pylônes du câble aérien,
sur une crête, dans la forêt. Le chemin des mines Luisa passe
au pied de ce pylône.

Détail
de la partie supérieure du pylône. Construit,
au début des années 1910, par assemblage de pièces métalliques
transportées à dos de mulet, ces pylônes ne sont pas trés
différents, dans leur principe, des pylônes des remontées
mécaniques des stations de ski actuelles. Le câble est en boucle,
avec une moitié descendante (à gauche) et une moitié
montante (à droite).

Pylône plus important que les autres
(double), permettant au câble de franchir un éperon entre deux
vallons descendant de l'arête
nord-est du pic Liena.
A l'arrière-plan, au-delà
de la vallée du rio Barrosa : à gauche le pic de Marty-Caberrou
(ou pico Salcorz ; 2676 m.) ; à droite le pico Las Maletas (2593
m.), au-dessus de la Punta Chusto (2416 m.) qui domine les installations
minières de l'Hôpital de Parzan.
(Remerciements à l'auteur de
la photo, Gilles Athier, pour avoir autorisé sa reproduction
; son blog [curiositéspyrenees.blogspot.fr]
contient de nombreuses autres belles photos des mines de Liena et du cirque
de Barrosa, ainsi que d'autres curiosités ou mines des Pyrénées).
Haut
de page

MONTAGE
DE PHOTOS montrant le câble :
- en haut : ses parties descendante et montante,
portant toutes les deux une benne, franchissent un épaulement sur un
pylône ;
- en bas, à gauche : un des éperons
rocheux franchis par le câble.
Au fond, de l'autre côté de la vallée
du rio Barrosa, le pic Marty Caberrou (ou Salcorz), au-dessus des "Planas
d'Abaixo". Derrière lui, à gauche, pointe le pic d'Aret
;
- en bas, à droite : le câble
a un diamètre de 24 mm, et comporte 6 torons de 7 fils chacun, autour
d'une âme de chanvre. Cette âme de chanvre était imprégnée
d'huile et il semble que sa fonction ait été d'empêcher
la rouille du câble.
Le câble se déplaçait à la vitesse
de 2 mètres par seconde (soit 7,2 km/h).

On peut se demander comment ces câbles,
aussi longs, et lourds (2,3 kg par mètre), étaient mis en place
dans ce terrain accidenté.
Selon un bon connaisseur de cette technologie (Jean Rudelle, auteur
d'un site
consacré à des mines de fer aveyronnaises) des tronçons
de câble, de quelques centaines de mètres en général
(voire plus d'un km), étaient portées à dos d'homme par
des ouvriers répartis le long du tronçon en file indienne, ou
à dos de mulets, puis reliées par des épissures pour
former le câble définitif. Cette technique de liaison (sertissage,
encore utilisé dans les stations de ski) était parfaitement
au point et n'augmentait pas le diamètre du câble et ne le fragilisait
pas. Les premiers tronçons posés servaient à véhiculer
les suivants.
(ci-contre, photo d'un transport de câble aux mines
de Pierrefitte, figurant dans les archives de Michel Parrou, illustrant un
article de Philippe Vivez, Le mythe des mines pyrénéennes,
eldorado ou descente aux enfers, paru dans la revue Pyrénées,
n° 199, 3-1999, p. 273 à 287).
On peut imaginer un autre processus (a-t-il été
utilisé ?) : mise en place d'un câble léger, facilement
transporté à dos de mulet, utilisé ensuite pour mettre
en place un câble plus lourd pouvant servir à poser le câble
définitif.
*
3.
La station supérieure

Vestiges de la station supérieure du téléphérique,
aux mines Luisa (2420 m), sur le versant est du pic Liena.
Le câble, qui était entrainé par la
roue qu'on voit au premier plan, mue par un moteur électrique, est
toujours là. Le pylône le plus proche de la station (qu'on ne
voit pas sur la photo) a été en revanche abattu par la neige.
Un des montants de la station porte la mention "Aciéries
de Longwy" (photo à droite).

Vue du système de poulies sur lequel circulait
le câble à l'entrée et à la sortie des bennes
de la station supérieure.
A l'arrière-plan, l'arête est du pic La Mota.
(photo Jean-Jacques Héran)

Autre vue du ystème de poulies
sur lequelles circulait le câble à l'entrée et à
la sortie de la station supérieure. Le câble est à terre,
avec deux bennes. Il existait probablement dans la station supérieure
un mécanisme analogue à celui de la station inférieure,
faisant transiter les bennes sur un rail (également à terre)
pour permettre leur remplissage. Deux bennes sont à terre, dont on
voit, à droite, le système de fixation sur le câble de
l'une d'elle.
Au loin, juste à droite des poulies, les pics Garlitz
et de Marty Caberrou (ou Salcorz).

Sous la station supérieure,
qu'on voit en haut de l'image, le premier pylône s'est effondré.
Haut de page

Vue de la partie de la station supérieure
où se situent le système de freinage qui s'exerce sur
le câble par l'intermédiaire d'un cylindre solidaire de la grande
poulie horizontale de renvoi du câble. (photo Jean-Jacques Héran).

Système de freinage vu
de près. Il était nécessaire quand le poids des bennes
pleines accélerait trop la descente de la moitié descendante
du câble chargée des bennes pleines, ou pour régler l'espacement
des bennes sur le câble.

Les engrenages de la station.
En bas, le type d'engrenage qui a inspiré le logo de la marque
Citroën.
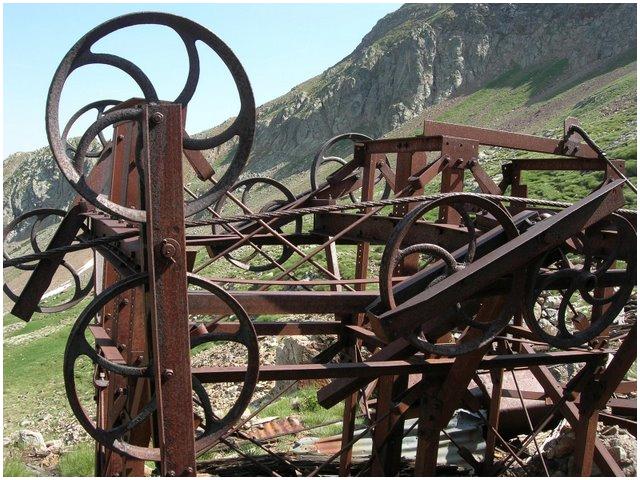


Trois PHOTOS du mécanisme complexe de la station
supérieure du câble transporteur des mines Luisa, comportant
notamment, outre un système de poulies, le système de freinage
et le moteur entraînant le câble. Moteur d'appoint car le déplacement
du câble ne nécessitait pas une énergie importante, le
poids des bennes pleines y suffisant en grande partie.
Ces constructions en métal résistent
mieux aux intempéries que les constructions en pierre : en effet dans
l'air sec de la montagne la couche de rouille superficielle protège
en profondeur le métal de la corrosion. Les parties métalliques
séjournant longtemps dans une atmosphère humide, par exemple
dans la neige, peuvent cependant finir par être corrodées entièrement,
mais au bout d'un temps de l'ordre du siècle
(source : un article de Philippe Vivez, Les chemins de
fer aériens des mines de Pierrefitte (Hautes-Pyrénées),
paru dans la revue Lavedan et pays toy, n° 32, spécial 2001).
*
4. Un pylône abattu

Un des pylônes les plus haut
situés a été abattu et plaqué au sol, tel
un paquet de nouilles. Les câbles restent en l'air, mais à 1
ou 2 mètres du sol.
.

Une de ses poutrelles a été sectionnée
au ras du socle du pylône.

Son système de poulies git
dans l'herbe en haut de la pente.

Quelques mètres au-dessous
du pylône abattu,la pince de fixation au câble d'une benne reste
fermée sur le câble, mais à l'envers et la benne proprement
dite a été arrachée à son support.

La PHOTO montre, derrière l'auteur
du site (qui a les pieds sur le pylône), les deux moitiés du
câble, et, au deuxième plan, sur la moitié ascendante,
la même pince à l'envers, et le support de la benne, plus
ou moins tordu, auquel la benne a été arrachée. Ce support
est en position oblique vers l'aval, et non en position tout-à-fait
verticale, ce qui ne peut s'expliquer que par le fait qu'il a fait un tour
(ou deux demi-tours) presque complet autour de son axe, l'axe du levier et
du ressort de celui-ci empêchant la position parfaitement verticale.
Les SCHEMAS illustrent :
- en haut, la rotation de 120° qu'a subie le chariot
autour du câble (et du câble lui-même s'il est resté
solidaire de celle-ci) et les rotations subies par le support de la benne
autour de son axe ;
- en bas, l'hypothèse selon laquelle on peut
tenter d'expliquer ce qui s'est passé, à savoir celle d'une
avalanche de neige poudreuse dont on connait la vitesse et la puissance
d'impact. C'est peut-être une telle avalanche
qui a abattu le pylône voisin (à noter qu'un vent froid et humide
peut recouvrir les pièces métalliques d'une carapace de givre
: ce qui peut décupler la prise au vent et à la neige du pylône
au point de l'arracher), et dont l'impact sur la benne a pu provoquer, outre
son arrachage, les rotations de son support, ainsi que celle de la pince autour
du câble. Il est probable que les câbles ont été
fortement malmenés.
VOIR AUSSI
-
des pages spéciales, consacrées
. au pic
Liena,
décrivant son ascension par le chemin
qui monte de l'Hôpital de Parzan aux mines Luisa
;
. à un projet
de câble aérien
entre le pic Liena et Gèdre ;
.
aux mines
du pic Liena
;
. au mécanisme
de fixation des bennes
sur le câble aérien des mines Luisa ;
- d'autres pages de photos, consacrées
. au "chemin
Luisa"
qui monte aux mines du même nom et permet de voir de près ce
câble ;
. à la station
d'angle qu'il
comporte ;
. aux mines
de Mallo Ruego,
et aux câbles aériens en général ;
. à la station supérieure
du câble
aérien de la vallée de La Gela.
- au
câble transporteur aérien transfrontalier
entre l'Hôpital de Parzan
et le Pont du Moudang
Liste
des pages de PHOTOS Haut
de page
Page d'accueil
NOTES
1.Voici
la carte de visite de cette société :

Page de photos mise à jour le 13 février 2021.